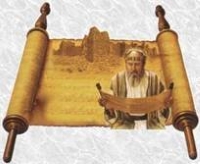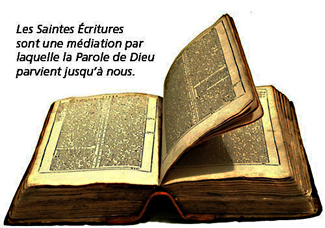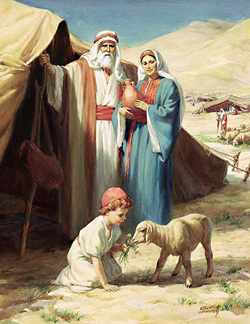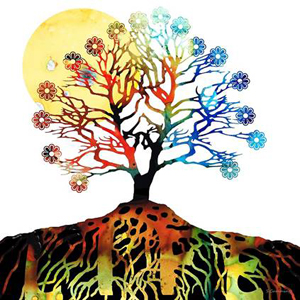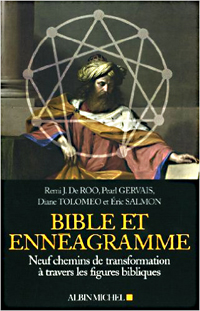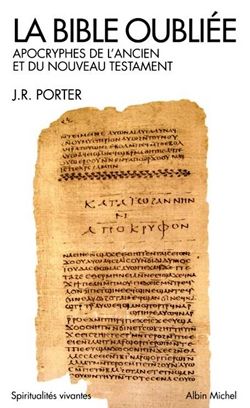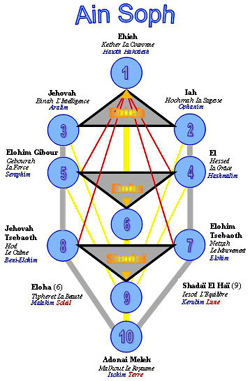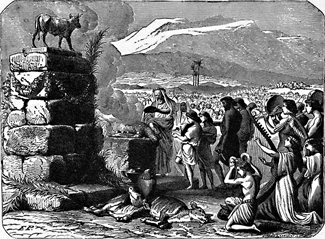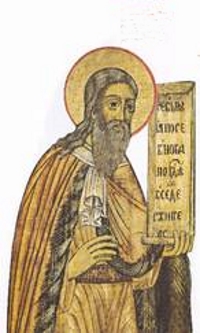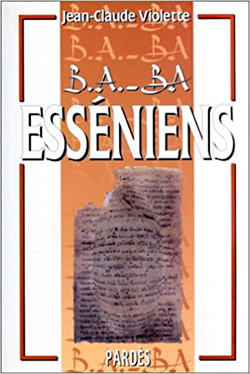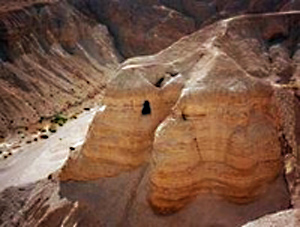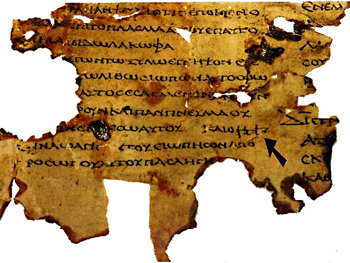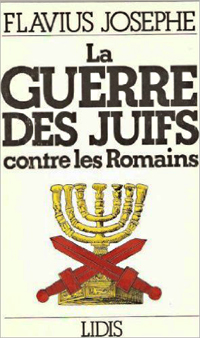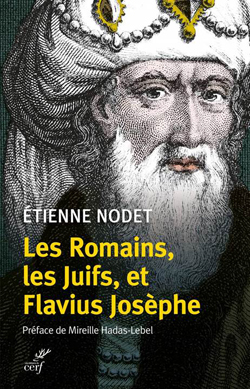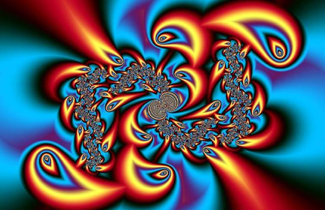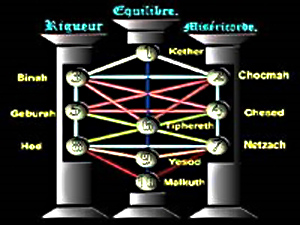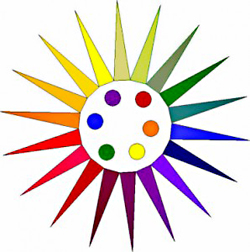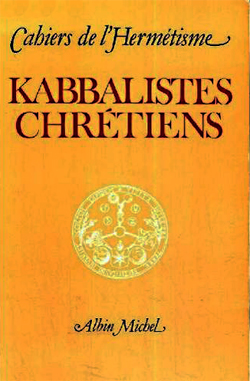|
Chapitre 6 A - K ( Judaïsme - Kabbale ) |
6 A
|
à bible ouverte
– la genÈse ou le livre de l’homme |
Josy
eisenberg & Armand abécassis |
Edition
ALBIN MICHEL |
2003 |
||
|
|||||
|
À BIBLE OUVERTE - TOME I - BERESHIT |
Josy Eisenberg et Armand Abecassis |
Edition Albin MICHEL |
1978 |
|
Depuis
25 ans, Josy Eisenberg anime la passionnante émission télévisée
« A Bible ouverte »
diffusée le Dimanche matin. Sous ce titre, ses entretiens avec le rabbin Armand
Abecassis furent publiés dans la collection Présence du judaïsme. Leur
succès est bien le reflet de l’intérêt grandissant des lecteurs de tous
horizons, croyants ou non, pour ce monument de l’humanité que constitue la
Bible. Il
justifiait pleinement une édition dont voici le Tome 1, consacré au
commentaire du début de la Genèse et de la création du monde. Alliant une
éblouissante érudition en matière d’exégèse rabbinique et de sciences
humaines (philosophie, sociologie, anthropologie, psychanalyse…) à un
dialogue vivant qui nous rend familier cette « Parole de Dieu »,
Josy Eisenberg et Armand Abecassis réussissent à nous faire sentir
l’éternelle actualité du récit de la Création, qui nous concerne, ici et
maintenant. Au sommaire de ces 28 entretiens : Pour lire la parole - Au commencement - Le Dieu créateur - Tohou-Bohou - Le premier jour - Les dix paroles - La première lumière - Un monde en six jours - Les deux calendriers - Du règne animal au règne de l’homme - Faisons l’homme - Le prototype humain - Notre ancêtre à tous - Le masculin et le féminin - L’homme et la croissance - Manger pour vivre - Le meilleur des mondes - Les miracles du sixième jour - La fin d’un monde - Le septième jour - Un temps béni - Un jour réparateur - Un monde qui enfante - La loi de la Terre - Entre Adam et Abraham - Une création double - Corps et âme - Le baiser de Dieu |
|||
|
À BIBLE OUVERTE - TOME II - ET DIEU CRÉA ÈVE |
Josy Eisenberg et Armand Abecassis |
Edition Albin MICHEL |
1992 |
|
L’histoire
du Paradis perdu hante la civilisation occidentale. Elle a fourni à ses
théologiens, ses philosophes, ses poètes et ses artistes, une série d’images
qui peuplent notre culture : le fruit défendu, la femme tentatrice, la
peine de vivre, la béatitude paradisiaque. Pour l’exégèse juive, attentive depuis deux mille ans à découvrir la substantifique moelle de ce récit, les chapitres 2 et 3 du Livre de la Genèse constituent le fondement de toute ontologie et de toute morale. Les discours des trois personnages du drame biblique –Adam, Eve et le serpent – recèlent le secret de tous les désirs, aspirations et fantasmes des hommes et des sociétés. Ces
discours, Josy Eisenberg s’est attaché, durant une année de dialogues
télévisés, à en montrer la modernité. Ce second tome de la série « A
Bible ouverte » en reproduit la teneur en respectant la dialectique
propre à cette quête érudite et passionnée. Au sommaire de ces 33 entretiens entre J. Eisenberg et A. Abecassis : Le jardin d’Eden - Les deux Paradis - Les fils de la géhenne - L’homme séduit - Le vert paradis - Les deux arbres - Adam avant, Noé après - Naissance de la Loi - Une frontière pour l’homme - Sept lois pour l’homme - Les lois de Noé - Quand rien ne manquait - Du coté d’Adam - Le premier face à face - La maison des parents - Un amour venu d’ailleurs - Une seule chair - Au royaume des innocents - Le tentateur - Un serpent qui sait des choses - Vous serez comme des dieux - Pourquoi Eve - La faute première - Le fruit défendu - Ils virent qu’ils étaient nus - La crainte du Seigneur - Le premier appel - Où es-tu ? - Tel qu’en lui-même - Adam dépouillé - La faute à qui ? - A la sueur de ton front - A l’est d’Eden |
|||
|
À BIBLE OUVERTE - TOME III - MOI, LE GARDIEN DE MON FRÈRE ? |
Josy Eisenberg et Armand Abecassis |
Edition Albin MICHEL |
1993 |
|
Après
un premier tome consacré à la création et un deuxième traitant de
l’apparition de l’homme et de la femme, voici la suite des entretiens
télévisés entre Josy Eisenberg et Armand Abecassis sur le livre de la Genèse
« Moi le gardien de mon frère ? » Le thème fondamental du quatrième chapitre étudié ici, c’est à travers l’affrontement entre Abel et Caïn, le phénomène social qu’es la rencontre de l’Autre et ses corolaires : la haine et le meurtre. Aussi
ce chapitre nous concerne t-il peut être davantage
que les précédents, nous qui vivons cernés par la violence. En quelques
versets, la Bible nous apporte une telle brassée d’enseignements sur les
motivations, les racines, les structures et les modes d’expression de la
violence, que l’histoire des Caïn et d’Abel en devient un archétype sans
lequel notre monde paraît inintelligible. Au sommaire de ces 29 entretiens : Un sursis de mille ans - Et Adam connut Eve - L’amour au paradis - le premier enfant - Un frère pour Caïn - Les sœurs de Caïn - Le pâtre et le laboureur - La première offrande - Caïn perd la face - Tu peux le dominer - Aux portes de la vie - Dialogue à une voix - Le partage et la guerre - Dieu avec moi - La troisième femme - La terre-mère - Le premier meurtre - Le gardien de mon frère - J’entend encore crier Abel - La terre et le sang - Tu couvriras son sang - Et tous ceux qui jamais ne naîtront - Et tu retourneras à la poussière - Porter la faute - Et où donc se cacher ? - Sept fois puni - Le signe de Caïn - A l’est d’Eden - La mort de Caïn |
|||
|
À BIBLE OUVERTE - TOME IV - JACOB, RACHEL, LÉA, ET LES AUTRES |
Josy Eisenberg et Armand Abecassis |
Edition Albin Michel |
1981 |
|
Jacob,
Rachel, Léa et les autres…Le peuple juif, l’une des deux grandes sources de
notre civilisation –l’autre étant la culture grecque – a eu pour ancêtres un
petit groupe d’hommes et de femmes. La Bible décrit longuement les
rencontres, les aspirations et les conflits de ces Patriarches et
Matriarches, qui ont donné naissance au peuple d’Israël à travers douze
tribus : Rubens, Siméon, Lévi, Juda, Issa’har,
Zebulon, Dan, Naphtali,
Gad, Asher, Joseph et Benjamin. D’incessantes ambigüités pèsent sur ce récit. Jacob aime Rachel, mais il épouse aussi Léa. Quels sont les deux amours qui vivent dans l’inconscient de chacun d’entre nous ? Le peuple hébreu est destiné à vivre sur la Terre Sainte ; pourtant, l’histoire que Josy Eisenberg et Armand Abecassis ont commentée dans leur quatrième année d’entretiens télévisés, se déroule tout entière en Syrie, dans un exil qui préfigure ma Diaspora. Onze
des douze fils de Jacob naissent en dehors de la Terre Sainte. Israël est-il
d’ici et d’ailleurs ? Quand à Jacob, il
traverse de multiples épreuves avant le combat final avec l’Ange. A la suite
de ce combat de ce combat, il prendra le nom d’Israël. Bien
qu’ayant fortement contribué à l’épanouissement de son beau-père Laban et de
son pays d’accueil, il suscite l’envie, la jalousie, la calomnie et la
haine. Quel rôle, réel ou phantasmatique, les juifs jouent-ils dans leurs
patries respectives ? Telles
sont quelques unes des questions auxquelles les
auteurs tentent de répondre en proposant, comme dans tous les tomes de
« A Bible ouverte », une synthèse de milliers de commentaires que
l’histoire de Jacob, de ses frères et de ses femmes a inspirés à vingt
siècles d’exégèse rabbinique. Au sommaire de ces 34 entretiens : 1e partie : Le puits de la Parole : La route de l’Orient – Jacob au pied léger – retour à l’Orient – les puits d’amour – les puits de science – les troupeaux d’Israël – Ô toi qui a soif – Puiser à Sion – le puits de justice et le puits de l’exil – 2e partie : La Rencontre : Bergers mes frères – Chalom mes frères – prend garde à tes moutons – Tel troupeau, tel berger – Le puits de l’exil – Physiologie de l’exil – Si tous les dispersés du monde – Jacob le puissant – une enquête rabbinique – la puissance de l’amour – Baisers volés – Le désir de la mère – de bouche à oreilles et de bouche à bouche – Des pleurs pour Rachel – Tel oncle, tel neveu – Israël, redresseur de torts – Les filles de Laban – Léa la pleureuse – 3e partie : Le mariage de Jacob : Une proposition honnête en attendant Rachel –Un étrange mariage – chastes fiançailles – la double méprise – Mère silence – Un retour de bâton – La loi du mariage – le temps des cadets – Jacob hors la loi – L’une est aimée, l’autre pas – Haïr la haine – L’amour caché – 4e partie : La naissance des tribus – Regardez mon fils, c’est le plus beau – Ecoute Israël – La troisième dimension – le salut par le Temple – un fils reconnaissant – merci ou mille grâces ? – Reconnaître pour être reconnu – le quatrième fils et la cinquième lettre – Donne moi des enfants – une prière dangereuse – les fils des servantes – Rachel réhabilitée – Zilpa – Léa récompensée – les amours de Jacob – Un fils pour Rachel – Le satan d’Esaü – la rumeur de Haran – Un Patriarche porte-bonheur – les trompettes de la renommée – 5e partie : Un conseil de famille – Douze, un nombre d’or – la fuite de Jacob, Pour quelques dieux volés – Pas un cheveu de Jacob – Malencontreuse malédiction – Jacob, mon ami, mon allié - Un nouveau discours 6e partie : Adieu Laban – Le complexe de Jacob – deux gardes pour Jacob – les juifs, un peuple soumis ? – Le bœuf et l’âne – Des animaux très spéciaux – Connaissance et reconnaissance – les angoisses de Jacob – un nombre maudit – une promesse fragile – Diviser pour survivre – Israël, peuple bicéphale – les armes d’Israël – Jacob le petit – Pitié pour les mères – le sable et les étoiles – Reproduction et sexualité – le temps de respirer – Le combat avec l’ange – Jacob seul – Le génie d’Esaü |
|||
|
À BIBLE OUVERTE - TOME V - UN MESSIE NOMMÉ JOSEPH |
Josy Eisenberg et Benno Gross |
Edition Albin Michel |
1983 |
||
Elle
porte en soi les promesses des temps où toutes les séparations seront
transmutées par la Réparation :
L’ère messianique. Les conflits qui opposent Joseph et ses frères concernent
nécessairement, en filigrane, le problème du Messie. Sera-t-il
fils de Joseph ou de Juda ? Ce thème va jouer un rôle fondamental dans
l’eschatologie juive ; et il n’est sans doute pas indifférent au lecteur
chrétien de constater que dans les évangiles, une double filiation est
attribuée à Jésus : il descend de Juda (à travers David) ; mais il
est aussi fils de Joseph. Deux Messies pour deux messianismes ;
et, en fin de compte, quel Messie pour l’humanité ? C’est là la
question, éternellement actuelle, qui traverse « Un Messie nommé
Joseph ». Au sommaire de ces 33 entretiens entre J. Eisenberg et B. Gross : 1e partie : Joseph le rêveur - Esaü, juif errant - Une cause qui demande réflexion - Vivre en paix - L’impossible bonheur - Un faux frère - De mauvais rapports - Joseph le hippy - Le fils de la vieillesse - Tel père, tel fils - Engendrer le Messie - Tunique : objet de mon ressentiment - Les frères ennemis - La folie des grandeurs - Ainsi en a décidé les dieux - Songes et mensonges - Plus haut que le soleil - 2e partie : La trahison des frères : Néfaste Sichem - La mission de Joseph - Les deux arches - L’appel des profondeurs - Des hommes et des anges - N’avons-nous pas tous le même père ? - La mort du frère - Le complexe de Ruben - Siméon et Lévi - Un puits sans eaux - Vingt pièces d’argent - Le retour de Ruben - Reconnais tu Joseph ? - 3e partie : Les amours de Juda : Les souterrains de la providence - Des enfants perdus - Le péché d’Onan - Une étrange prostituée - La route de Timna - Tamar prend le voile - La porte des yeux - Epouse, mère et reine - Celle par qui le scandale arrive - Une naissance mouvementée - 4e partie : De la prison au trône : La descente en Egypte - L’ascension de Joseph - Le pain de Putiphar - La roue de la fortune - La tentation de Joseph - Joseph touche le fond - Joseph le devin - La vigne du Seigneur - Le pain et le vin - Quand le Pharaon rêve - L’Egypte, don du Nil - 5e partie : Joseph le nourricier : Un jeune, un Hébreu, un esclave - Un plan septennal - Le savoir et le pouvoir - Joseph l’Egyptien - Joseph fait des réserves - Economie et sexualité - Oublier et prospérer - 6e partie : Les retrouvailles : Et ils ne le reconnurent point - Sortir de la crise - Sur les lieux du crime - Une grave accusation - L’otage de Joseph - Plus de Joseph, plus de Siméon - On dine au palais - Et comment va votre vieux père ? - Le piège se referme - Des ténèbres à la lumière, de la servitude à la liberté - Nous sommes tes esclaves - Je suis Joseph votre frère - Deux arbres qui n’en font qu’un |
|||||
|
À BIBLE OUVERTE - TOME VI - LE TESTAMENT DE MOÏSE |
Josy Eisenberg et Benjamin Gross |
Edition Albin Michel |
1995 |
|
La
personnalité de Moïse tient une place unique dans l’histoire et la
tradition juive. Prophète, fidèle porte voix de
Dieu, il libère le peuple juif de son esclavage en Egypte pour le conduire en
Canaan, à l’orée de la Terre promise. Seul homme à avoir dialogué en « face à face » avec Dieu, il accomplit
une œuvre fondamentale de législateur dont rendent compte les quatre premiers
livres de la Bible. Ce
n’est qu’au cinquième livre, sentant sa mort prochaine, qu’il prend
personnellement la parole. Ainsi est né le Deutéronome : l’homme
de Dieu se fait homme, nous livre ses états d’âme et sa propre vision de
l’histoire. Livre étonnant où se mêlent tous les genres littéraires, où le
prophète apparaît tour à tour comme mémorialiste, témoin, juge, législateur,
moraliste mais aussi Cassandre, prophète du bonheur et visionnaire. Son
regard embrasse alors les siècles. Avec une stupéfiante précision, il prédit
les ombres et les lumières du destin tourmenté du peuple juif. Ecrit
par Josy Eisenberg, rabbin, historien, écrivain, producteur et réalisateur de
télévision, associé à Benjamin Gross, docteur en philosophie, doyen honoraire
de la faculté de Lettres et Sciences humaines de l’université de Bar-IIan, le testament de Moïse constitue une indispensable
voie d’accès à la compréhension du lien qui unit le peuple biblique de l’état
d’Israël dans la géopolitique d’aujourd’hui . Au sommaire de ces 29 entretiens répartis en 5 parties ; 1e partie : Souviens toi Israël : Moïse à la première personne - Lieux de mémoire - La justice en tête - Ces peuples, tes frères - Prends garde à toi - 2e partie : Du haut de la montagne : Au delà du soleil - Une seule fois, une seule fois - Variations sur un thème divin - Voix de feu - 3e partie : Ecoute Israël : L’Eternel est Un - Tu aimeras l’Eternel - Partout et toujours - 4e partie : Une terre de miel et de dard : Le pays de tous les dangers - Au désir de Dieu - Terre bénie - Les Tables brisées - Amour et crainte - Dieu puissant, Dieu d’amour - 5e partie : La nouvelle société : A boire et à manger - Les fils de Dieu - Manger pour vivre - Le cri du cœur - Des juges et des rois - Refuges - Les sentiers de la guerre - Responsabilité illimitée - Epilogue : Mort où est ta victoire ? - Quand il est mort le prophète |
|||
|
abraham –
enquÊte sur un patriarche |
Abraham
segal |
Edition Bayard |
2003 |
||
En effet, il craint d’être tué s’il se
présente comme mari d’une si belle femme. Le Pharaon prend Saraï pour femme,
et Abram reçoit de nombreux cadeaux. Mais Dieu inflige de grands malheurs au
Pharaon, qui après avoir reproché son mensonge à Abram, les congédie. Alors qu’Abram passe par le
Néguev, il se sépare de Loth, son neveu. En effet, leurs troupeaux sont
tellement grands que le pays ne subvient plus à l’ensemble de leurs besoins.
C’est ainsi que Loth partira s’installer à Sodome (Abram mènera par la suite
une expédition pour libérer Loth qui a été fait prisonnier). Abram accepte la
proposition de Saraï qui, pour avoir un fils, lui donne sa servante
égyptienne Agar comme femme Tombée enceinte, Agar méprise Saraï, qui s’en
plaint à Abram. Comme il répond qu’elle peut faire d’Agar ce qu’elle veut,
elle la maltraite et provoque sa fuite. Après avoir vu un ange, Agar revient
et donne naissance à Ismaël. Treize ans après, Abram a 99 ans.
Dieu lui apparaît et lui propose à nouveau une Alliance... Dieu le nomme
Abraham, car il lui promet de nombreux descendants. En échange, Abraham et
ses descendants devront le reconnaître comme leur Dieu, et pratiquer la
circoncision sur les enfants mâles. Dieu change aussi le nom de Saraï en
Sarah et promet qu’elle enfantera dans un an un fils : Isaac. Dieu
annonce qu’il va à Sodome et Gomorrhe pour juger ces villes, dont la
population se conduit mal. Abraham le supplie de ne pas détruire Sodome s’il
y trouve 50 justes. Dieu accepte, puis Abraham négocie jusqu’à obtenir que 10
justes sauvent la cité. Dieu s’éloigne, et Abraham rentre chez lui. Mais Dieu
ne trouvera pas 10 justes et le lendemain, Sodome est anéantie, mais Dieu a
épargné son neveu Loth et ses enfants. A la naissance d’Isaac, Sarah
demande à Abraham de chasser Ismaël. Elle ne veut pas qu’Isaac ait à partager
l’héritage avec Ismaël… Abraham en est contrarié, mais Dieu lui dit d’écouter
Sarah car l’Alliance passe par Isaac. Alors Abraham chasse Agar et Ismaël. Un
jour, Dieu demande à Abraham d’offrir Isaac en holocauste sur le Mont Moriah.
Après trois jours de marche, il demande aux serviteurs de garder l’âne et
charge Isaac des bûches. Sur la route, Isaac demande où est l’agneau qui sera
brûlé. Abraham répond qu’il s’en remet à Dieu. Une fois arrivés, Abraham
élève un autel, dispose les bûches et lie son fils au bûcher. Alors qu’il
tend la main pour immoler Isaac, un ange, convaincu de la crainte qu’il place
en Dieu, crie à Abraham d’épargner Isaac. Un bélier, qu’Abraham voit pris au
piège dans un fourré, est sacrifié à sa place. L’ange bénit Abraham et
s’engage à faire proliférer sa descendance, promettant que toutes les nations
de la terre se béniront en elle. Ségal réussit le tour de force de nous raconter, sur le rythme
d’une intrigue policière, à travers la figure d’Abraham et sa postérité, nos
plus universelles interrogations sur la condition humaine.. |
|||||
|
AGGADOTH DU TALMUD DE BABYLONE – LA SOURCE DE JACOB
– Ein Yaakov - |
présentation de M.A. OUAKNIN |
Edition VERDIER |
1982 |
|
Les
principales aggadoth du Talmud de Babylone, rassemblées par Rabbi Jacob Ibn
Habib au XVIe siècle sous le titre Ein Yaakov ( la source de Jacob),
constituent le trésor de la tradition juive qui, transmise oralement depuis
l’Antiquité biblique, fut ensuite transcrite à partir du IVe siècle de notre
ère : récits légendaires, interprétation de textes bibliques, épisodes
grandioses ou tragiques de l’histoire d’Israël, recommandations d’ordre
religieux, moral ou même pratique, leçons sur le juste et l’injuste, sur le
pur et l’impur. Des
générations de disciples des sages, se commentant les uns les autres à
travers les siècles, ne laissent rien oublier de ce qui fait l’existence
quotidienne juive, ni de ce qui fonde la vision juive du monde et de sa
finalité. Dans
cet ouvrage, l’intégralité des six ordres du Talmud de Babylone est
représentée ; il contient la majeure partie des aggadoth, choisies par
Rabbi Jacob Ibn Habib, sous la forme d’une cinquantaine de traités, disposés
selon l’agencement traditionnel. Un index permet le repérage des personnages
bibliques, thèmes et notions le plus fréquemment rencontrés. Au sommaire de cet important ouvrage de 1400 pages : Ordre Zera’im (semences) -
Berakhoth - Péa - Demaï -
Kilaiym - Chevi’it - Ma’asser Cheni -
Bikourim - Ordre Mo’ed (temps fixé) -
Chabbat - Erouvin - Pessahim - Yoma
- Soucca - Betsa - Roch hachana -
Ta’anith - Meguilla - Mo’ed katan -
Haguiga - Ordre Nachim (femmes) - Yebamoth
- Ketouboth - Nedarim - Nazir -
Guittim - Sota - Kiddouchin - Ordre Nezikin (préjudice) - Bba
kamma - Baba metsi’a - Baba Bathra -
Sanhédrin - Makkoth - Chevou’oth -
Edouiyoth - Avoda Zara - Horaiyoth - Ordre Kodachim (choses saintes) - Zebahim
- Menaoth - Houlin
- Bekhoroth - Arakhin
- Temoura - Keritoth
- Me’il a - Tamid
- Midoth - Kinnim
- Ordre Taharoth (choses
pures) - Kelim -
Niga’im - Nidda
- Yadaiym - Ouketsin
- |
|||
|
A LA RECHERCHE DE L’UNITÉ, ExÉgÈse
biblique et Kabbale des lettres. |
Roland BERMANN |
Edition DERVY |
1996 |
||
Alors que nous gagnons en
compréhension et en intimité avec le Zohar, notre conscience s'approfondit et
se déploie. Spirituellement, nous mûrissons et évoluons. Nous devenons qui
nous avons besoin d'être pour gagner la joie et la plénitude que Dieu a
voulues pour nous. Le Zohar est comme un miroir dans lequel nous voyons nos
propres attentes et intentions. Certains décrivent le Zohar comme
un simple texte spirituel parmi d'autres ou un objet d'étude académique. Ils
le trouvent difficile et même rébarbatif - ce qu'ils trouvent était en fait
déjà déterminé par ce qu'ils cherchaient à trouver. A contrario, les plus
grands esprits de l'histoire ont trouvé la sagesse et l'illumination dans les
pages du Zohar. De Pythagore, dans la Grèce ancienne, à Sir Isaac Newton,
jusqu'aux architectes de la biologie et de la physique contemporaines, les
étudiants de la Kabbalah et du Zohar ont découvert des informations et des
visions sidérantes. A un niveau pratique et personnel, le Zohar ne révèle pas
seulement des principes spirituels qui peuvent nous aider dans nos vies
quotidiennes, il nous donne aussi le pouvoir de mettre en action ces
principes. Cela se produit dans tous les domaines de nos vies, nos relations,
notre travail spirituel, et même notre travail et notre carrière. Le Langage du Zohar : Le Zohar est écrit en araméen, une langue sœur de l'hébreu
qui utilise des lettres hébraïques. Alors que l'hébreu était la langue des
classes supérieures, l'araméen était la langue des gens ordinaires. La
révélation du Zohar en araméen est une indication que cet outil de Lumière
peut et devrait être utilisé par tout le monde, indépendamment du niveau
spirituel. Au-delà de l'importance de la langue araméenne, même les lettres
prises individuellement ont une signification particulière. Dans la vie de
tous les jours, nous avons l'habitude de penser aux lettres de l'alphabet
français en termes purement fonctionnels. Les lettres sont des unités que
nous assemblons pour créer des mots, tout comme des briques pour créer un
mur. Nous pensons aux lettres et aux briques en termes pratiques plutôt que
spirituels - elles ne sont que de petits objets inertes que nous utilisons
pour créer de plus grands objets. Les lettres de l'alphabet hébreu
(utilisées en araméen et en hébreu) doivent être comprises de façon
entièrement différente. En plus de leur importance fonctionnelle comme
composantes de mots, chaque lettre est un canal pour une forme unique
d'énergie spirituelle et cela est vrai que nous sachions ou non comment
prononcer la lettre ou comment elle se place dans un mot donné. L’alphabet
araméen est un don du Créateur, tout comme le Zohar lui-même. Ce don est
destiné à toute l'humanité, pas seulement à la minorité qui connaît les
langues hébraïque et araméenne anciennes. Scanner les lettres - laisser
simplement vos yeux passer sur elles - ouvre un accès illimité à la Lumière. Une source d'énergie
spirituelle : Non seulement le Zohar révèle et
explique, mais il apporte littéralement bénédictions, protection et bien-être
dans la vie de tous ceux qui viennent en sa présence. Rien d'autre n'est
requis qu'un désir sincère, la certitude d'un coeur confiant et un esprit
ouvert et réceptif. Le but ultime du Zohar est d'apporter la Lumière dans nos
vies, et donc d'apporter la plénitude complète. Le Zohar est par conséquent
une opportunité pour nous de transformer notre nature. Déclencher cette
transformation est la raison pour laquelle les enseignements de la Kabbalah
existent, et pourquoi le Zohar devrait toujours être dans nos maisons, nos
pensées et nos cœurs. On y trouve: les 2 Adams,
l’approche du Divin, l’alphabet hébraïque de l’Aleph au Tav et du Tav à
l’aleph, la mer d’airain, la pierre et l’eau, l’arbre des Séphirots et les 4
mondes de la Kabbale. |
|||||
|
ANCIEN TESTAMENT B.A-BA |
GERARD
CHAUVIN |
Edition
PARDES |
2004 |
|
Diffusée
annuellement à plusieurs millions d’exemplaire, traduite en mille
langues et dialectes, la Bible est Le Livre par excellence. Livre
sacré des juifs, auxquels fut révélée la Loi de Dieu par l’intermédiaire du
prophète Moïse au Sinaï ; livre sacré des chrétiens, qui
universaliseront le message, destiné a priori au peuple hébreu. Pour les
« gens du livre », le crédo biblique est simple « Je suis Dieu, il n’en est pas d’autre ».
Dans
la forme familière que nous lui connaissons, la Bible résulte de multiples
inspirations prophétiques, de traditions orales, de compilations et de
réajustements, et ce, durant une dizaine de siècles… Elle ne sera fixée, à la
lettre près, qu’avec l’œuvre magistrale des massorètes, à l’aube du Moyen-
Âge.
|
|||
|
aperçus sur l’ÉsotḖrisme de l’histoire
d’Abraham |
Jacques
THOMAS |
Edition
Arche – Milan |
2002 |
|
Ce
livre réunit une série d’étude portant sur certains aspects symboliques et
ésotériques de l’histoire d’Abraham telle que la rapporte la Genèse et
diverses traditions anciennes. C’est le déroulement de sa vie et sa
réalisation spirituelle avec ses différents étages. Un des lieux où les hommes
allèrent s’établir après le déluge s’appelait Ur. Ur devint une ville
importante, avec de belles maisons. Mais ses habitants servaient de faux
dieux. Ceux de Babel aussi. Tous ces gens ne ressemblaient pas à Noé et à son
fils Sem, qui, eux, servaient Jéhovah. Le fidèle Noé mourut 350 ans après
le déluge, soit deux ans avant la naissance de l’homme que vous représente
l’image. Cet homme plaisait beaucoup à Jéhovah Dieu. Il s’appelait Abraham et
demeurait avec sa famille dans la ville d’Ur. Un jour Jéhovah dit à Abraham: ‘Quitte
la ville d’Ur ainsi que ta parenté pour le pays que je t’indiquerai.’ Que fit
Abraham? Obéit-il? Oui. Il partit, tournant le dos aux attraits de la ville.
Abraham obéissait toujours à Dieu et devint ainsi l’ami de Dieu. Parmi les siens il y en eut qui
quittèrent Ur avec lui. Partirent avec lui son père Térah, son neveu Lot et
naturellement sa femme Sara. Après un long voyage, ils arrivèrent à une ville
appelée Haran. C’est là que mourut Térah. Ur était loin. Au bout d’un certain temps, Abraham et
sa famille quittèrent Haran et arrivèrent au pays de Canaan. C’est là que Jéhovah
lui dit: ‘Voici le pays que je donnerai à tes descendants.’ Abraham resta en
Canaan. Dieu favorisait Abraham, qui finit par avoir d’importants troupeaux
de petit bétail et de gros bétail, ainsi que des centaines de serviteurs.
Mais sa femme Sara était stérile. Quand Abraham eut 99 ans, Jéhovah
lui fit cette promesse: ‘Tu deviendras père de beaucoup de nations.’ Comment
cela se pouvait-il puisque Abraham et sa femme avaient passé l’âge d’avoir des enfants?........................ |
|||
6 B
|
BIBLE ET ENNÉAGRAMME - Neuf Chemins de transformation à travers les figures bibliques |
Remi J. De Roo, Pearl Gervais, Diane Tolomeo et Éric Salmon |
Edition
Albin Michel |
2013 |
||
Au début des années 1915, avec la révolution russe, Gurdjieff avait développé cette étude, qui d’ailleurs existe toujours dans de nombreux centres. La base de sa pensée était de « tuer le Moi afin de redevenir soi-même », il développe une quatrième voie qui consiste à équilibrer les trois centres – (centre de la colère, des instincts – centre des pensées et de la peur - centre des émotions), afin de reprendre le contrôle conscient de sa vie. Vers les années 1970, en Californie, de nombreux « chercheurs en humanité » vont développer un mouvement « transpersonnel », avec comme base de recherche, les considérations de Carl Gustav Jung : La psyché a des dimensions cosmiques Toute âme a besoin de transcendance L’individu a besoin de se relier au sacré Jung est le premier de ces psychologues à ne pas s’être arrêté au seul fonctionnement intellectuel et affectif, mais à être passé du personnel au transpersonnel, à avoir eu la conviction que l’homme, fondamentalement, est en quête d’une dimension supérieure de lui-même. Dans les années 1960 un philosophe bolivien Oscar Ichazo, a l’idée d’associer la symbolique du diagramme aux axes passions/vertus des Pères du désert. Aux 7 péchés capitaux il y ajoute le mensonge et la peur, cette nouvelle donne fera école. Notre démarche ésotérique nous a appris de la psychologie et de l’anthropologie que de nombreux symboles de notre inconscient (que Jung appelle les archétypes), ainsi que d’autres projections de notre vie psychique, se manifestent à travers nos rêves, dans les mythes et les contes de fées de toutes les cultures et civilisations. Les histoires de la Bible ne font pas exception, elles fonctionnent de la même façon que nos rêves et nos contes. Jung a résumé leur pouvoir en expliquant l’influence des archétypes : « L’impact d’un archétype, qu’il prenne la forme d’une expérience immédiate ou qu’il s’exprime par le biais de la parole, nous attire parce qu’il fait appel à une voix plus forte que la notre. Celui qui parle avec des images primordiale parle avec la puissance de mille voix ; il fascine et domine, tout en soulevant l’idée qu’il cherche à exprimer l’occasionnel et le transitoire par un monde qui supporte tout. » La Bible est un des plus grands recueils de ces histoires qui nous touchent et rattachent notre histoire à une histoire plus universelle. C’est parce que le mystère de notre existence est ineffable, inexprimable directement par des mots, que les récits bibliques, comme d’autres textes sacrés, utilisent des histoires, des mythes, des paraboles et quantités d’images pour exprimer des vérités trop complexes pour le langage ordinaire de chacun. Ces histoires et archétypes pénètrent profondément dans notre inconscient, et touchent notre âme à de telles profondeurs qu’ils peuvent mettre un certain temps à refaire surface. Des histoires comme Adam et Eve au jardin d’Eden ou celle d’Abraham, de Joseph, de Moïse, de Salomon et d’autres nous impactent bien au-delà d’une fascination habituelle d’un récit normal. Au sommaire de cet ouvrage magistral de 360 pages, on nous parle de : La bible et l’Ennéagramme - Lire la Bible - L’Ennéagramme - Les profils conciliants - Jean Baptiste et Paul - Ruth et Booz - Pierre et la mère des Maccabées - Les profils assertifs - Salomon et la Samaritaine - Marthe et la Cananéene - Saül et David Les profils en retrait - Job et Marie-Madeleine - Joseph et Nicodème - Abraham et l’homme de la piscine - La spirale de la transformation de la pensée au mysticisme |
|||||
|
bible
- histoire & statut de l’homme |
e.m. laperrousaz |
Edition
Paris Méditerranée |
2002 |
|
Ce
spécialiste de QOUMRÂN, propose ici quelques réflexions concernant l’histoire
des religions et particulièrement dans le domaine biblique. On
y parle de la Palestine, d’Israël, du peuple élu, la protohistoire d’Israël,
de l’exode à la monarchie, les mystères du mont Sinaï, les prophètes, les
rois, les prêtres, les messies, Ezéquiel, Jésus, tout cela dans un cadre
dépassionné de religiosité humaine. |
|||
|
bible –
les cinq livres des sages : les proverbes de salomon – le livre de job –
qohélet ou l’ecclÉsiaste – le livre de sira & la sagesse de salomon |
Edition
Maurice gilbert |
CERF
|
2002 |
|
Les
« livres de sagesse » de l’Ancien Testament, moins commenté que d’autres
textes de la Bible, attirent de nouveau l’attention en ce début du XXIème
siècle. Le malheur a voulu que les sagesses antiques, celles du Proche-Orient
ancien dans lequel s’inscrit la sagesse d’Israël, disparaissent souvent même
avant l’ère chrétienne. La Bible, qui a conservé par écrit ces témoignages
(fait presque unique dans l’histoire de l’humanité), permet d’accéder à des
siècles de culture. Et, de nos jours, la valeur formatrice de ces dictons,
proverbes et réflexions sur la vie de l’homme sur terre frappe d’autant plus
que la modernité la menace.
|
|||
|
bible –
les grands thÈmes de l’ancien testament |
Christian eckl |
Edition
LA MARTINIERE |
2006 |
|
Qui
était vraiment Moïse, et pourquoi a-t-il fait sortir les Hébreux d’Égypte
pour les conduire vers la Terre promise ? Qu’en est-il de Joseph et de ses
frères, de Samson et Dalila, de Sodome et Gomorrhe, ou de Daniel dans la
fosse aux lions ? Quelle est l’origine de ces histoires et pourquoi ont-elles
joué un rôle si important dans la religion et la théologie judéo-chrétienne,
et dans la littérature comme dans l’art ? Cet
ouvrage nous présente l’Ancien Testament et ce qui se cache derrière ses
grandes figures ; les réalités archéologiques et la part du mythe. |
|||
|
BIBLE OUBLIÉE - APOCRYPHES DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT |
J. R. Porter |
Edition Albin Michel |
2004 |
||
Pourtant ils ne disparurent jamais complètement, particulièrement dans les régions périphériques, comme par exemple en Ethiopie où la Bible utilisée par l’Eglise éthiopienne comprend le premier livre d’Enoch et le Livre des Jubilés, ainsi que de nombreux autres textes issus des courants hébraïques et gnostiques des premiers siècles. Au sommaire de cet ouvrage de 400 pages : Première partie : Les écrits hébraïques perdus : Au commencement - La création du monde - la création des anges - les anges et leurs actions - la chute de Satan et les anges rebelles - Adam et la chute - les rythmes du temps - Hénoch le sage - la venue du Fils de l’Homme - Visions cosmiques - Mathusalem, Noé et Melchisédech - Paroles de Patriarches - Le testament d’Abraham - l’Apocalypse d’Isaac - les testaments de Jacob et d Joseph - Joseph et Aséneth - le testament de Moïse - Ecrits perdus des prophètes - les vies des prophètes - Les testaments de Job et de Salomon - l’Apocalypse d’Elie - le martyre et l’Ascension d’Isaïe - les oracles sibyllins - Psaumes et Odes de Salomon - Deuxième partie : Les écrits perdus du Nouveau Testament : Les années manquantes de Jésus - les grands-parents du Christ - Légendes de la Nativité - Histoires de l’enfance de Jésus - les Evangiles des judéo-chrétiens - Les Evangiles de la Passion - Les Evangiles de Pierre, de Nicomède et de Barthélemy - le rapport et la mort de Pilate - Les mystères gnostiques - l’hérésie gnostique - L’Evangile de vérité - l’Evangile de Philippe - L’Evangile copte de Thomas - Dialogue avec le Christ - Les légendes des Apôtres - Actes apocryphes - les actes de Pierre, de Jean et de Paul - le martyre de Pierre - Paul et le lion - Paul à Philippes - Paul à Corinthe - le martyre de Paul - les actes d’André - Thomas en Inde - Magdonia et Karish - Rites sacrés et prières - le martyre de Thomas - Troisième partie : Visions de la fin des temps : Les apocalypses de Pierre, de Paul et de Thomas - les apocalypses gnostiques - la sibylle chrétienne - Lettres aux fideles perdus - Abgar et Jésus - la lettre aux Laodicéens - Paul et Sénèque - la lettre du Pseudo-Tite - les prédications de Pierre - la lettre des Apôtres - Cette anthologie des textes apocryphes est un monument de la littérature ésotérique et religieuse, elle réunit tous ces textes pour une lecture facile, agréable et ordonnée. |
|||||
|
BIBLICA - ATLAS DE LA BIBLE |
Sous la direction du Professeur BARRY BEITZEL |
EDITION DE LODI |
2008 |
|
Conçu
sous la forme d’un atlas, dont les huit chapitres peuvent aussi se lire comme
un livre, Biblica
met à la disposition du lecteur toutes les informations nécessaires pour
accompagner la lecture de l’Ancien et du Nouveau Testament. Cet atlas nous fait faire un voyage historique et
culturel sur les terres de la Bible. De très nombreuses citations bibliques, 125 cartes, 650
documents en couleur, des arbres généalogiques, un glossaire, un index
particulièrement complet font de Biblica un outil
de découverte et une source documentaire inégalable. Une
équipe pluridisciplinaire internationale de 27 universitaires parmi les
spécialistes les plus réputés en a rédigé les études et la notice dans une
forme particulièrement accessible à un très large public. L’établissement
des cartes et le choix des illustrations de Biblica
ont été supervisés et rigoureusement contrôlés par des auteurs
spécialisés. Chaque passage de la bible évoque des femmes et des hommes, des
lieux, des événements, dont l’histoire et l’archéologie confirment qu’ils ont
fourni aux récits bibliques un environnement réel. Lire la bible, y chercher la référence d’un épisode ou d’un
personnage, c’est entrer dans un univers complexe et fascinant, entre
Occident et Orient, entre passé et présent : l’histoire de l’art y
côtoie les données géopolitiques de plusieurs continents, la théologie prend
en compte des découvertes archéologiques fascinantes, comme celle des
manuscrits de la mer morte et les Esséniens de Qumram. Peut-on
imaginer un atlas plus riche, mieux documenté, plus accessible que Biblica pour
éclairer le livre fondateur de toute une civilisation. Un magnifique Atlas, très facile à lire et très pratique sur
le plan de la recherche, seul son format peut être gênant, mais le positif
est que les photos et cartes sont sur papier glacées couleur, et sont d’une
lecture magique dans ce format. Un incontournable. Format 32 x 42. Poids 7 kg. Prix :
90€ neuf (Amazone, Fnac) On le trouve d’occasion à 70€ |
|||
6 C
|
cAbAle et cabalistes |
Charles
mopsik |
Edition
BAYARD |
1997 |
||
Deuxième partie : Textes choisis - La
tradition ésotérique - Dieu et le monde divin - la
Torah - L’homme, son âme et son action - Les
techniques mystiques - Le destin d’Israël et l’exil de Dieu
- Rédemption et messianisme - Troisième partie : Fidélité et réappropriations. Une tradition éclatée - Les institutions traditionnelles - Les nouveaux centres d’étude de la cabale - La cabale populaire, dans la pensée et dans sa recherche contemporaine - |
|||||
|
COMMENTAIRES
INITIATIQUES SUR LA KABBALE |
Edouard
OUTIN |
Edition
Dervy |
2001 |
|
La
kabbale, tradition mystique du judaïsme, a depuis ses origines été l’objet de
multiples interprétations : historique, théologique, psychologiques,
initiatique… La présente étude constitue l’une de ces approches. Nouvelle et
fort originale, elle explore la mystique pour mieux comprendre les phénomènes
humains, car en plus d’être une quête du spirituel et de Dieu, la kabbale est
une étude de soi-même pour approcher au plus prés
son de venir, et ainsi retrouver son équilibre en même temps que son
créateur. La kabbale devient, en quelque sorte, une science thérapeutique ou
« kabbalothérapie ». Le
sujet, bien qu’inhabituel et ardu, est traité de manière claire et
accessible, l’auteur passe en revue les thèmes principaux et essentiels de
cette tradition, puis propose des règles et des méthodes pour s’y initier et
devenir kabbaliste. Des parallèles thématiques avec le
Christianisme ; l’Islam, et le Bouddhisme apportent une profondeur et
une richesse aux sujets abordés. Cette initiation ne demande pas de
dispositions intellectuelles particulières ou exceptionnelles : tout un
chacun peut le réaliser, pourvu qu’il s’adonne sérieusement à l’étude et à la
pratique de cette science. Au sommaire de cet ouvrage : Chapitre 1 et 2 : Tradition Abrahamique et aspects
historiques. Chapitre 3 L’homme et son devenir – La création du monde
et la notion du mal - La théorie de Rabbi Yishaq
Luria - De la vie caché de Dieu à la structure psychique de
l’homme - L’évolution spirituelle et le processus de
Rédemption - Le rachat du monde : Le Tiqqoun
- Chapitre 4 : Interprétation du kabbalisme
théosophique du Zohar selon Luria - Chapitre 5 : Interprétation extatique d’Abraham Aboulafia
- Chapitre 6 : Applications et méthodes - Les aspects
moraux et philosophiques - Les grandes règles - Le
Maître - Chapitre 7 : Principe et guides d’accès - Les
quatre mondes - L’Arbre de Vie - Les correspondances
maçonniques de l’Arbre de Vie et de la Kabbale - Les
correspondances des chakras sur l’Arbre séphirotique - Les
sentiers de l’Arbre de Vie - Chapitre 8 et 9 : La guématria, la triade et l’octave
- Chapitre 10 et 11 : L’Eglise et l’Arbre
séphirotique - Les Sephiroth et le Christianisme
- Un excellent livre pour qui veut s’initier à la kabbale |
|||
|
concerto pour quatre consonnes sans
voyelles |
Marc-Alain ouaknin |
Edition
BALLAND |
1991 |
|
Comme
une source souterraine, la Kabbale parcourt, irrigue et enrichit la tradition
juive. Mais elle n’est pas que son apanage ; sans doute recèle-t-elle aussi
des richesses propres à alimenter les débats contemporains de la cité
d’Occident…
|
|||
|
considÉrations ÉsotÉriques sur les 12
fils de jacob |
Georges
ruchet |
Edition
TREDANIEL |
1992 |
|
Une
œuvre ésotérique et métaphysique sur la place de l’homme dans l’Arbre de vie,
à travers ses dimensions transcendantales et véritables et ce dans une
optique kabbalistique. Dans
l'Ancien Testament, Israël est présenté comme une communauté à structure tribale,
depuis le moment de son apparition en tant que peuple, au début de l'Exode,
jusqu'à l'établissement de la monarchie en terre de Canaan. Les tribus, qui
sont au nombre de douze, correspondent aux douze fils du
patriarche Jacob (Genèse, xxix-xxx),
que celui-ci eut de quatre femmes. Léa lui donna Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon ; Rachel lui donna Joseph (qui
est remplacé dans certains textes, lorsque Lévi n'est pas nommé, par ses deux
fils Ephraïm et Manassé) et Benjamin ; Bilhah,
une servante, lui donna Dan et Nephtali ; enfin, Zilpah, une autre servante, lui donna Gad et Asher. La
seule énumération complète des fils de Jacob est celle des Bénédictions
(Genèse, xlix). Dans les
autres textes bibliques, les listes sont sujettes à des variations et
laissent supposer que l'organisation tribale de l'ancien Israël est trop
complexe pour être expliquée par une seule famille. La constance du nombre
douze est artificielle et n'existe que pour rappeler les liens du sang, réels
ou supposés, entre tous les membres du peuple. C'est par ces listes
généalogiques que la communauté tribale exprime son unité. Pour certaines
écoles (M. Noth, par exemple), la fédération
des douze tribus d’Israël rappelle l'amphictyonie grecque,
c'est-à-dire la réunion d'une communauté autour d'une tombe centrale, celle
d'un ancêtre commun. D'après
les textes bibliques, l'unité des tribus réside dans le culte de l'unique
Yahvé, qui a libéré son peuple de la servitude en Égypte, ce culte se
matérialisant autour de l'Arche d'alliance. Cependant, sur la stèle de Merneptah (~ 1236-~ 1223), Israël est mentionné au nombre
des peuples conquis par ce pharaon en Canaan, alors que, d'autre part, à la
même époque, au moins une partie du peuple d'Israël se trouve encore en
Égypte. Cela serait un argument pour dire que les douze tribus n'ont pas
traversé le désert en une seule fois, dans l'unité parfaite, sous la conduite
de Moïse En
partant de Joseph on y découvre : Les
initiations, les nombres 11 et 12, le serpent, la Kundalini, la langue des
oiseaux, Béréshit, le monde solaire, Sion et Jérusalem, l’Adam Kadmon, les
Sephiroth, la Shekinah, Métatron et le Christ. |
|||
|
contes & lÉgendes de la
bible – juges, rois & prophḔtes |
M. khan |
Edition
POCKET |
1995 |
||
Pendant
les 450 ans qui s'étaient écoulés depuis que le peuple juif était entré en
Erets Yisrael, Jérusalem était restée imprenable.
C'était une ville-Etat habitée par une tribu cananéenne appelée les Jébusites (le village arabe de Silwan
en occupe aujourd'hui le site). Elle était puissamment fortifiée, mais elle
présentait une grave faiblesse malgré son apparence inexpugnable : Son seul
approvisionnement en eau était une source qui s'écoulait hors des murs de la
ville. Cette source s'enfonçait à l'intérieur de la ville par un long tunnel
découpé dans le roc. Le
livre de Samuel et celui des Chroniques décrivent comment le général de
David, Joab, escalada un tsinor (littéralement :
" tuyau "), entra dans la ville et la conquit. Certains
archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du " puits de Warren " -
un tunnel vertical grimpant depuis la source du Gui'hon
- devenu une attraction touristique dans la " ville de David ",
hors des murs de la Jérusalem d'aujourd'hui. La première chose que David a
réalisée après avoir conquis la ville a été d'en
faire sa capitale. Il faut ici nous poser la question : Pourquoi Jérusalem ? On
aurait certainement pu trouver des sites plus appropriés pour en faire la
capitale d'Israël. Jérusalem n'est pas au bord d'un important cours d'eau ni
ne se situe sur une route commerciale. Toutes les capitales dans le monde
sont construites au bord d'un d'océan, d'une mer, d'un fleuve ou d'un lac, ou
au moins près d'un itinéraire commercial majeur. Il y avait à cette époque
plusieurs grands axes commerciaux à travers Erets Yisrael
: la " Route du Roi ", l'un des axes les plus importants de tout
l'ancien Moyen-Orient, qui partait du Golfe d'Aqaba sur la Mer Rouge et
rejoignait Damas. Le pays était également traversé par la
Via Maris (" voie de la mer ") qui courait depuis l'Egypte le long
de la côte méditerranéenne jusqu'en Syrie. La
capitale d'Israël aurait dû se trouver au bord de la Mer Méditerranée. Un
endroit comme Jaffa (aujourd'hui banlieue de Tel Aviv) aurait été un choix
idéal. Donc : pourquoi Jérusalem ? La raison de son choix tient à un aspect
très particulier du peuple juif, et à l'accession des enfants d'Israël au
rang de nation. Les nations commencent normalement d'exister après avoir
occupé un territoire pendant une longue période, et après avoir développé une
langue et une culture communes. Après une période d'expérience nationale
partagée, ils se sont groupés autour d'une identité nationale spécifique.
Cela est vrai pour toutes les nations. Quant aux Juifs, ils sont devenus un
peuple peu de temps après avoir échappé à l'esclavage en Egypte. Ils n'étaient
pas encore en Erets Yisrael, ils ont campé dans un
no man's land, dans le désert, au pied de Mont Sinaï. C'est là qu'ils sont
devenus une nation, quand ils ont fait alliance avec Dieu, promettant de
" faire et d'entendre ". La nation d'Israël est définie, en tout
premier lieu, par son rapport collectif avec Dieu. Il va donc s'avérer qu'il
n'existait pas de meilleur endroit pour s'unir à Dieu que Jérusalem. Aussitôt
que David a fait de Jérusalem sa capitale, il a acheté une petite colline au
nord de la ville, qui appartenait à Aravna le Jébusite. L'achat est mentionné à deux reprises dans la
Bible (II Samuel 24, 24 et I Chroniques 21, 25). Cette colline est le Mont Moria. C'est en ce lieu qu'Abraham a offert Isaac en
sacrifice, puis a déclaré : "Dieu verra ", dont on dira aujourd'hui
: " Sur la montagne de Dieu, Il sera vu" (Genèse 22, 14). C'est en
ce même lieu que Jacob a rêvé d'une échelle s'élevant vers le ciel, puis a
dit : "Que ce lieu est redoutable ! Ce n'est autre que la maison de Eloqim, et c'est la porte des cieux" (Genèse 28,
17). Il n'est pas étonnant que cet endroit soit devenu celui que tous les
grands conquérants de l'histoire ont voulu posséder. Jérusalem a été conquise
ou détruite 36 fois. La
Bible est le plus grand des livres de rêves. |
|||||
6 D
|
dans le silence de l’aleph |
Claude
vigÉe |
Edition
ALBIN MICHEL |
1992 |
|
Il
existe en nous un bon et un mauvais silence. Le bon silence, c’est celui de l’écoute,
celui de l’ouverture de l’âme à l’art, à la lumière et à la nuit, à la parole
initiale dont toutes les autres ont pu sortir dans la durée d’une vie. Nous
durons, nous parlons, nous survivons d’instant en instant par la grâce de ce
lieu saint caché en nous-mêmes, que l’auteur Claude Vigée
identifie à l’Aleph, première lettre de l’alphabet hébraïque et symbole de
l’Un originel. « L’expérience
de la guerre et de l’exil m’ont appris dès ma première jeunesse à avoir soif
de ce lieu dit-il, les circonstances m’ont
contraint à creuser un tunnel souterrain jusqu’à lui ». Ce
cheminement intérieur, Claude Vigée nous en livre
ici l’essence, à travers une méditation fondée sur son interprétation de la
Révélation biblique : interprétation à la fois très personnelle et
poétique, enracinée dans la plus pure tradition judaïque, en particulier dans
ce joyau de la mystique juive qu’est la kabbale. Au sommaire de cet ouvrage de méditation intérieure : Première partie : La mélodie de l’Un
- La lucarne de l’arche - La chambre
forte du don immérité - Vers l’ailleurs
matinal - Dans la matrice nocturne de la Terre
promise - Jacob affronte l’ange
- Le pont étroit - Deuxième partie : L’humain encore à naître
- La foi et la loi - La demeure
secrète - La conscience-bon plaisir
- Où finit le règne des anges ? -
L’image inversée de l’élection d’Israël - Déchirure
et invention de la parole - Pierre à feu et pierre de
source - |
|||
|
deux clefs initiatiques de la lÉgende
dorÉe : la kabbale
et le yi-king |
Pierre
stables |
Edition
Dervy |
1975 |
|
Ces 2 grandes voies nous enseignent avec des méthodes
différentes que le but est le même. On y parle de :
La Voie descendante et ascendante
La Voie de la lune et du soleil
La Voie des heures de la journée
La Voie sacrificielle Les théophanies, les eaux protectrices St
jean, St Jacques, le feu, la parole perdue, les 4 éléments, le
domaine initiatique, l’œil, la réintégration, etc. |
|||
|
DICTIONNAIRE AMOUREUX DU JUDAÏSME |
JACQUES ATTALI
|
Edition
PLON |
2009 |
|
De
sa plume alerte, l’auteur nous conte l’Histoire des grandes figures mythiques
qui ont façonnées le judaïsme, par exemple : JOB
Un
procureur, déclare, qu’il a parcouru toute le Terre, et qu’il n’a rencontré
aucun croyant véritable car aucun homme ne croit en Dieu d’une façon
totalement désintéressé. Pour lui prouver qu’il a tort, dieu décide alors de
mettre à l’épreuve l’homme le plus croyant, le plus intègre, le plus riche,
le plus heureux du moment : Job
|
|||
|
DICTIONNAIRE DES FEMMES DE LA BIBLE - |
Michel
Legrain |
Edition
du Cerf |
2015 |
||
Ouvrant
ces portraits, il faut bien parler d’Eve! Beaucoup, pour parler d'elle, ont
des mots au parfum de pomme acide. Eve ne mérite peut-être pas tout cela.
Quand elle apparaît, ils sont deux à chercher tant bien que mal les chemins
de Dieu, l'oreille encore si mal affinée à sa voix... On retiendra qu'Eve est
nommée, au terme du récit de la Genèse, « mère des vivants » (Gn 3). Car
c'est toujours de vie que parle la Bible. La Genèse voit alors défiler de
grandes figures, avec lesquelles nous parcourons les premiers sables bibliques. Ainsi Sarah, déjà âgée, rit de ce
qu'elle entend de l'étranger qui passe et dans lequel le lecteur reconnaît
l'ange de Dieu. Il parle de naissance alors qu'elle se sent toute
sèche, trop vieille pour rouvrir le chapitre des imprévus et de la vie. Elle
rit. Et l'enfant qui naîtra d'elle, puisqu'elle enfantera, s'appellera
l'enfant du rire, selon le jeu de mots hébreu qui entoure le nom d'Isaac (Gn
18). Puis
vient Rébecca, qui entre dans l'histoire d'Isaac par la porte du courage et
de la fidélité à l'accueil, au respect de l'étranger de passage, à la vie.
Elle ne ménage pas sa peine au bord du puits, pour les chameaux de l'étranger
qui arrive. Bien lui en prend, car c'était pour lui le signe attendu.
Et il la ramène vers Isaac, son maître, qui désirait une femme prête à un
grand rêve, à une histoire où Dieu aurait sa place. Rébecca épouse Isaac. (Gn
24). Bien sûr on se souvient de sa rouerie quand Jacob devenu vieux et
rendu aveugle par l'âge, doit donner sa bénédiction à l'aîné, Esaü. Elle, de
ces deux jumeaux terribles, semble préférer Jacob, et l'aide à obtenir la
bénédiction paternelle qui échappe à Esaü. Celui-ci pleure de s'être fait
ainsi ravir la bénédiction de l'aîné. Ainsi Rébecca aide son fils Jacob,
l'assoiffé de bénédiction et de Dieu !... (Gn 27). Mais
traversons ainsi le temps, et voici Myriam, qui aime tellement chanter
qu'elle emporte tout le monde dans son chant. Le temps a passé depuis
Rébecca. Le peuple a connu la servitude d'Egypte. Et si Myriam entreprend de
chanter son étonnement pour Dieu, c'est que le peuple a traversé la mer sous
la conduite de Moïse, son frère (Ex 15). Son chant est le premier grand,
immense cantique du peuple de la Bible, au Dieu qui fait franchir la mort.
Franchissons les siècles. Et l'on aimerait ne pas oublier Rahab, la prostituée
de Jéricho, qui a l'oreille fine à la "parole du Seigneur" (Jos 2)
! Rahab, la merveilleuse païenne qui ouvre ainsi les portes de Jéricho aux
envoyés de Dieu, pour que le peuple qu'il aime entre en terre promise. Ruth
a une histoire différente. Elle est du pays de Moab. Elle est étrangère et a
épousé un fils du pays de Juda venu par-là, mais a connu très vite le
veuvage. Par fidélité à sa belle-mère, ou peut-être par amour pour son amour
qui n'est plus, elle vient au pays de Juda. La Bible dit avec gratitude et
presque tendresse sa fidélité à la Parole de Dieu ! Parvenue au pays de Juda,
elle ira errer en pauvresse sur les champs moissonnés par Booz, pour y
glaner. Elle glanera gros, puisque Booz la remarque et la choisit pour en
faire sa femme. D'eux
naîtront Jessé et sa lignée, l'arbre de Jessé, l'arbre généalogique de David
et... du Messie. La tradition juive chantera la foi de Ruth ? Mais de quelle
nature est-elle exactement ? Devenue ainsi en sa ténacité et sa fidélité,
l'ancêtre du Messie. (cf. livre de Ruth). Et il
nous faut aller plus loin vers le Nord, aux confins de la terre du Liban, un
siècle plus tard peut-être. Comment ne pas évoquer en effet cette autre
figure merveilleuse, de la femme que rencontre le prophète Elie au temps de la
sécheresse et de la famine. On ne sait rien d'elle, pas même son nom, juste
sa peine, elle que l'on appelle simplement la veuve de Sarepta. Elie lui
demande à manger et, alors que ce sont ses dernières ressources avant de
mourir, elle et son fils, elle donne son reste de farine et d'huile. Comme si
elle pressentait que l'identité même de Dieu est résurrection, vie plus
grande, plus forte que la mort, et qu'avec ce Dieu là au coeur, on peut
donner (1 R 17) ! On comprend, à regarder la vie de ces femmes trempées
au rythme de Dieu, que les prophètes aient aimé comparer Jérusalem à une
femme. Une femme dévoyée quand c'est le péché qui emporte le coeur de
Jérusalem. Une veuve dévorée par le chagrin au temps de l'Exil, une femme
resplendissante de beauté au temps où Dieu ramène son peuple des terres du
mal et de l'Exil. Marie, dans le Nouveau Testament, sera cette grâce venue du ciel et habitant au pays des hommes. Une disponibilité intégrale à la Parole, au point qu'en elle la Parole venue de Dieu se fait chair. Et l'humanité passe de façon nouvelle aux saisons de Dieu, ouvrant le temps pour chaque homme, chaque être, d'un enfantement. D'autres femmes splendides traversent avec discrétion les évangiles, le temps de semer la vie, d'accueillir le pardon, de renaître, d'aimer. On pense à toutes ces Marie dont les visages se sont fondus, au fil de la tradition, avec celui de Madeleine, celle dont on dit tout aujourd'hui, au rythme des films et des romans. Elle a simplement laissé saisir sa vie pour que s'y inscrive, avec le pardon, la résurrection de Jésus. Il est des êtres de lumière qui éveillent ainsi l'humanité et la sauvent. On reconnaîtra en eux la parole de Dieu, énoncée sans ombre, au coeur de notre histoire. |
|||||
|
dictionnaire encyclopÉdique de la
kabbale |
Georges lahy (Virya) |
Edition Lahy |
2005 |
|
Ce
dictionnaire encyclopédique contient une synthèse des termes et expressions significatives,
en hébreu et en araméen, rencontrés couramment dans les grands textes de la
Kabbale. Certains mots sont très populaires, largement connus et souvent
développés dans la littérature générale. En revanche, ce dictionnaire, en
plus des mots ordinaires, contient des appellations beaucoup plus
spécialisées, issues de divers courants de la Kabbale ou spécifiques à
certains grands textes. C’est pourquoi, ce livre se propose d’être, aux
débutants, en quête d’informations élémentaires sur la Kabbale, qu’aux
chercheurs avertis, se livrant à l’étude des enseignements kabbalistiques. Un
lexique, en fin de livre permet de faire une recherche à partir des mots en
français. |
|||
6 E
|
élie ou l’appel du silence |
Michel
masson |
Edition
du CERF |
1992 |
||
Il
se rend alors sur l’Horeb – autre nom du mont Sinaï – où lui est octroyée la
révélation de Dieu. Par ordre divin il est renvoyé vers le nord où il
organisera l’avenir d’Israël par personnes interposées (son successeur
Elisée, et les rois Hazael et Jéhu) tandis qu’il
veille à l’ordre yahviste en accablant de punitions miraculeuses Achab, sa
femme Jézabel et son fils Ochosias ainsi que des
militaires trop attachés à ce dernier. Enfin, pour couronner cette
prodigieuse carrière, il est élevé au ciel.
|
|||||
|
essai sur la pensÉe hébraïque |
Claude
tresmontant |
Edition
du Cerf |
1956 |
|
C’est
avec la grande pensée, celle des philosophes de la Grèce, que l’auteur
compare la pensée biblique et révélée. Ce dialogue est au cœur de notre
civilisation et se poursuit avec le christianisme. L’auteur
nous fait participer à ces réflexions et nous baignons dans le dogme
chrétien, la théologie chrétienne, la Révélation, la Grèce antique et ses
philosophes et la pensée biblique. Au sommaire de cet excellent livre : Chapitre 1 : La création et le crée - le
temps - le temps et l’éternité
- Création et fabrication, l’idée de matière
- Le sensible, le symbolisme des éléments, le particulier
- le Mâshal - Chapitre 2 : Schéma de l’anthropologie
biblique - L’absence du dualisme âme et
corps - La dimension nouvelle ; le
pneuma - Chapitre 3 : L’intelligence - le
cœur de l’homme - la pensée et l’action
- l’intelligence spirituelle qui est la foi -
Le renouvellement de l’intellect et la philosophie chrétienne
- Chapitre 4 : Le néo-platonisme de Bergson
- le souci - La pensée hébraïque et
l’Eglise - |
|||
|
ESSÉNIENS
B.A – BA |
Jean
Claude VIOLETTE |
Edition
PARDES |
1999 |
||
Le témoignage qui retient immédiatement notre attention est celui de Flavius
Josèphe, car il est particulièrement complet. Si ce dernier connaissait
parfaitement les spéculations esséniennes, c’est qu’il a vécu, dans sa
jeunesse, auprès d’un ascète nommé Bannus,
pour le moins essénisant. Il nous précise, à ce sujet, que les Esséniens se
préoccupaient de la formation des jeunes, leur donnant des principes moraux
très stricts et une instruction d’un haut niveau. Au sommaire de ce livre : Témoignages historiques - paléographie
- la communauté de Qumram - le commentaire d’Habacuc
- le maître de justice - le rouleau des Hymnes
- le livre d’Hénoch - le livre de Tobie
- les certitudes des Esséniens - Jésus et les
Esséniens - |
|||||
|
ESSÉNIENS le livre secret des
éssḖniens |
Olivier
manitara |
Edition
VEGA |
2004 |
|
Pour
l’auteur, les Esséniens sont devenus au fil du temps, un peuple, une école de
prophètes, un état de conscience et un modèle de l’homme vivant en profonde
harmonie avec la nature. Les
esséniens étaient des juifs vivant en communauté installés dans le désert de
Judée, à Qumran, et dont on a retrouvé les manuscrits (dits «de la mer
Morte») en 1947. Ils avaient traversé deux mille ans dans des jarres,
elles-mêmes dissimulées dans des grottes. Malgré le temps qui avait dévoré
les contours des rouleaux, on a réussi à reconstituer des textes et des
fragments de texte.
Les
esséniens se représentent Dieu comme un principe de totalité. L'homme, en
tant que chair, est le néant. Ils attachent à Dieu le caractère d'unité, avec
les mêmes caractéristiques que le Verbe dans l'Évangile de Saint Jean. Le
Verbe – si on ne précise pas quelle personne, quel temps, quel verbe – serait
l'essence de l'action, le «chaos», le «tout», le «tohu-bohu» que les cathares
considéraient comme le principe du monde. Les hommes sont entre
l'esprit mauvais et l'esprit bon, ils peuvent s'identifier à l'un ou à
l'autre. Dans l'essénisme comme dans le zoroastrisme, c'est Dieu qui a créé
ces deux esprits. Le Bien : c'est la totalité, l'infinité, l'autorité. Il
inclut donc le mal ; or ce dernier est néant car il n'est que lui seul. Les
esséniens, comme les cathares, rejetaient le monde. Ils lui associaient le
mal, la corruption, la luxure, le péché. On y trouve:
la
lumière, Moïse et le mont Sinaï, Thot et les 10 paroles du soleil, les 10
commandements, l’arbre de vie, et la Kabbale, le lâcher prise, les clés de
méditation, la voie intérieure, et la philosophie des Esséniens adaptée à
notre monde. |
|||
|
ESSÉNIENS – LES MANUSCRITS DE
LA MER MORTE |
ANDRÉ
PAUL |
EDITION
BAYARD |
1998 |
||
André
Paul suit
dans son livre la chronologie du Père de Vaux, qui bien avant lui raconta
cette histoire et ses trouvailles puisqu’il a fait parti
à partir de 1949 de ceux (Ecole biblique de Jérusalem) qui fouillèrent et
retrouvèrent les parchemins oubliés dans les 11 grottes. La question du
Maître de Justice n’est pas très évoquée, mais on se reportera aux livres de Laperrousaz pour approfondir cette question. Il souligne par contre les différences radicales entre l’orientation
élitiste des Esséniens et le christianisme. |
|||||
|
ESSÉNIENS
les trois hauts-lieux de judÉe |
e.m. laperrousaz |
Edition
PARIS MEDITERRANEE |
2001 |
|
Dans
la Judée du temps de Jésus 3 sites constituent des lieux particulièrement
importants : Massada, palais forteresse symbole de la révolte des Juifs
contre les Romains, l’Herodium, forteresse
puissante ayant servi de refuge aux Zélotes et Qumram établissement religieux
fondé par les Esséniens, cette communauté de Juifs désirant vivre dans le
désert par une voie ascétique. Massada, est l'un des sites archéologiques les
plus somptueux et les plus visités d'Israël. Situé au sommet d'un piton
rocheux quasiment imprenable, la forteresse de Massada surplombe à l'Ouest le
désert de Judée et à l'Est la Mer Morte. Le sommet, 450 mètres au-dessus du
niveau de la Mer Morte, est accessible en une heure de marche par le sentier
du serpent ou en quelques minutes en téléphérique. Massada dévoile alors sa
beauté sauvage, en particulier à l'aube, au lever du soleil. En 2001, le
site, a été inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Les événements tragiques qui, à la fin du
premier siècle de notre ère, virent les Zélotes juifs occupant la forteresse,
se donner la mort plutôt que de tomber entre les mains des légionnaires
romains font de Massada, un symbole de l’identité culturelle juive mais
aussi, plus universellement, du perpétuel combat entre oppression et liberté.
La chute tragique de Massada marque la fin du royaume de Judée et de la
période du Second Temple. Après la période Byzantine, Massada est tombé dans
l'oubli et n'a été redécouvert qu'au XXème siècle. Les fouilles conduites
dans les années soixante ont permis de mettre à jour l'histoire de la
citadelle et de découvrir des milliers d'objets qui témoignent du
développement culturel à la fin de la période du Second Temple. Construit par Hérode, roi de Judée, Massada a
été bâti comme un complexe de palais-forteresse. Au pied de la montagne, on
peut voir les huit camps romains, les fortifications et la rampe d'assaut
construite en terre et en pierre sur la face ouest du piton rocheux. Ces
vestiges constituent le plus ancien témoignage qui subsiste à ce jour des
travaux de siège menés par la légion romaine. A l'extrémité nord du plateau
de la forteresse, se dresse le palais nord du roi Hérode. Un palais bâti sur
trois terrasses surplombant la gorge profonde en contrebas. Près du palais,
des thermes romains, avec leurs parterres de mosaïques aux couleurs vives et
leurs fresques murales. Au centre du plateau, le fastueux palais ouest, le
mikvé -bain rituel juif- des tours de guet, une synagogue, et des entrepôts.
Dans ces magasins les archéologues ont retrouvé des milliers d'objets
quotidiens, des jarres, de la poterie décorée, des pièces de monnaie ou
encore des parchemins. Au
pied de cet édifice le tout nouveau musée de Massada présente neuf salles,
chacune d'elles étant consacrée à un thème. On peut y découvrir les
trouvailles archéologiques les plus importantes exhumées lors des fouilles du
site. Trois des salles sont dédiées à Hérode. La première dépeint un banquet
royal dans le palais nord avec les ustensiles de table originaux et la
présentation des plats et des boissons qui étaient offerts aux invités
royaux. La seconde salle met en scène l’histoire du port de Césarée qu’Hérode
fit construire, et par lequel transitaient les produits les plus précieux. La
troisième salle présente les magnifiques fresques et bas-reliefs colorés qui
ornaient le palais d’Hérode, et à partir desquels il est possible de se faire
une idée du luxe et du faste mené à la cour du roi de Judée. Le
site de Massada comporte deux entrées. L'une sur la face Ouest accessible par
la route 3199 via la localité d'Arad. L'autre entrée, sur la face Est,
accessible par la route 90 (Jérusalem-Eilat). Il n'y a pas de route reliant
ces deux entrées. De façon générale, le complexe de Massada offre aux
visiteurs toutes les facilités Au
sommaire : sont présents les manuscrits de la mer morte, le maître de
justice, Bar Kochba, et Flavius Josèphe. |
|||
|
ESSÉNIENS qumram – l’Établissement
essÉnien des bords de la mer morte |
e.m. laperrousaz |
Edition
Picard |
1976 |
|
L’auteur ancien pensionnaire de l’école
archéologique française de Jérusalem, nous fait partager les travaux qu’il a
effectués à Qumram dès 1970. des plans et des photos
illustrent le livre. C'est sur la rive septentrionale du Wâdi Qumrân que se trouvent les vestiges des
installations communautaires dites du même nom. Rappelons que le terme de
« Qumrân » n'est attesté qu'à partir de 1884, dans un récit
d'explorateurs britanniques ; c'est sans nul doute la variation phonique
de l'anglais Gomorrha,
« Gomorrhe », la ville mythique dont on recherchait alors les
traces dans ces régions. Le site archéologique contient les ruines d'un
complexe communautaire de grande taille, ayant en gros la forme d'un
quadrilatère de cent mètres de long et quatre-vingt
de large. Ce sont les restes d'importantes installations conçues pour une
expérience de vie commune, durable et réglée. Au cours de l'année 1997, on
apprit la découverte toute récente d'un précieux ostrakon ou
« tesson » sur l'un des murs d'enceinte : on pourrait y lire
le mot hébreu yahad, que nous traduisons par
« commune ». Ce même terme figure entre autres dans le titre de
l'un des grands écrits connus depuis 1947, dont les restes d'une bonne
dizaine d'exemplaires seront recueillis dans les grottes de Qumrân : la Règle
de la commune. Bien des données suggèrent des liens entre cet écrit
normatif et l'établissement près duquel on l'a trouvé. Si l'on s'appuie sur
les conclusions des archéologues, il est quasi certain que la phase
significative de l'occupation des lieux prit fin lors de la défaite de la
résistance juive contre Rome, avant ou plutôt après la chute de Jérusalem, en
70. Elle a pu débuter entre 130 et 120 av. J.-C., plus tôt même.
L'aventure aurait duré deux siècles sans guère d'interruptions, mais non sans
évolution. L'établissement de Qumrân possédait les
infrastructures et les équipements collectifs nécessaires à une existence
communautaire rythmée par des pratiques et définie par des rites. On repère
parmi d'autres la salle des assemblées, qui sert aussi de réfectoire, avec
l'office adjacent et la cuisine ; l'atelier de céramique avec les fours,
et surtout l'aqueduc et les canaux, les citernes et les bassins à escaliers
destinés à des bains fréquents de purification : on descendait impur
dans l'eau pour en remonter purifié. On est frappé
par le système que les ingénieurs d'alors ont su concevoir et mettre en œuvre
pour la collecte saisonnière, le stockage, la conservation et la distribution
de l'eau. Il faut ajouter la ou les bibliothèques. On discute encore sur
l'existence ou l'emplacement d'un possible scriptorium. On n'a pas
trouvé de trace de locaux d'habitation dans l'enceinte construite. En dehors
des prenantes activités diurnes et hormis tel acte ininterrompu, ainsi la
lecture de la Loi de nuit comme de jour, les membres de la communauté
vivaient ailleurs, dans les environs proches et à la manière de troglodytes.
Les grottes, surtout celles qu'ils creusaient dans la craie, étaient en effet
leur abri, une température clémente s'y maintenant malgré les variations
saisonnières. Les indices d'une habitation certaine ont été relevés dans une
quarantaine d'excavations. Il ne faut pas exclure l'utilisation de tentes. Voilà pour le domaine des vivants.
Celui des morts le jouxtait d'une façon surprenante. Il y a d'abord un
cimetière que l'on dit principal, à une cinquantaine de mètres à l'est des installations
bâties. On y compte quelque onze cents tombes, d'hommes seulement
semble-t-il : elles sont disposées en rangées ordonnées que des allées
divisent en trois sections. Toutes sont alignées sur un axe nord-sud, les
corps étendus sur le dos, la tête au sud. Il existe deux autres cimetières
bien moins importants, qui comptent ensemble une centaine de tombes, l'un au
nord et l'autre au sud du cimetière principal : on y a identifié des
corps de femmes et d'enfants. Il semble que le cimetière principal ait été
réservé aux membres à part entière de la commune : ceux qui, à en juger
par certains écrits retrouvés sur place, remplissaient les conditions d'âge,
d'initiation et de probation afin de participer aux divers actes ou exercices
collectifs, les repas en priorité. À la grande différence des coutumes
instaurées dans la société juive, qui inhumait les défunts à l'écart des
agglomérations, à Qumrân, le monde des morts, lui-même organisé sinon réglé,
ne faisait qu'un avec le monde des vivants, dont il était à sa façon comme le
cliché en négatif. L'établissement de Qumrân n'est pas le
seul à avoir été exploré dans la région. À quelques kilomètres au sud se
trouve un autre site important, du nom de Khirbet Feshkhâ. Les ruines rappellent celles de Qumrân, mais la
finalité des installations paraît toute autre. Avec hangars, magasins et
locaux administratifs, elles évoquent davantage une annexe économique, base
de l'activité agricole et de l'artisanat. À quinze kilomètres au sud de
Qumrân, à Aïn Ghûwéïr, oasis de deux kilomètres de
long sur les bords de la mer Morte, on a retrouvé un autre site qui rappelle
en moins grand celui de Qumrân. Il y a une cuisine, peut-être à proximité
d'un réfectoire : des poteries semblables à celles du premier
établissement y étaient entreposées. Au nord se trouve un petit cimetière
avec aussi des squelettes de femmes et d'enfants. Il appert donc que, en
dépit de leur importance, les installations communautaires de Qumrân
n'étaient pas les seules à l'époque dans les abords occidentaux de la partie
nord de la mer Morte. Ce constat est de la plus haute importance pour
l'identification des occupations respectives, successives ou simultanées. De 1947 à 1956, plusieurs dizaines
d'excavations ou de grottes furent explorées dans les environs plus ou moins
proches de Qumrân. Dans onze d'entre elles, on retrouva des manuscrits en
nombre et en qualité variables : certains avaient été déposés dans des
jarres. De ces cachettes on retira quelques rouleaux bien conservés, mais
surtout des milliers de fragments aux dimensions elles-mêmes diverses :
elles vont de celles de plusieurs colonnes à celles de vraies miettes. Le
déchiffrement et le regroupement de la multitude des pièces furent
étonnamment rapides. Commencé en 1953, pour l'essentiel le travail était
achevé en 1960. Il en ira tout autrement pour la publication : après un
bon début, puis des essoufflements et des crises, il fallut attendre la fin
du siècle pour disposer de la totalité des textes. L'ensemble des pièces
découvertes représente quelque huit cent cinquante écrits ou livres
différents. La datation, celle de la copie et non de la rédaction première,
oscille entre le IIIe siècle av. J.-C. et le milieu
du Ier siècle chrétien. On classe les onze grottes dans l'ordre
chronologique de leur découverte,. Mais on se doit de distinguer aussi deux
catégories de grottes : celles qui sont proches et peu ou prou
dépendantes de l'établissement de Qumrân, artificielles ; et celles qui
sont éloignées du site, naturelles. La vie des Esséniens, leur environnement et
la détection de leur implantation jusqu’à leur disparition sont ici décrits
par un archéologue. Un livre excellent. |
|||
|
ESSÉNIENS - SECTE DE
QUMRÂM – MANUSCRITS et MAÎTRE DE JUSTICE |
DIVERS
AUTEURS |
ARCADIA |
2008 |
||
E.M Laperrousaz, professeur, grand historien et archéologue,
spécialiste du Moyen Orient nous parle des Esséniens, du Maître de justice,
des découvertes archéologiques, et de cette gnose pratiquée par cette secte
des Esséniens qui par bien des cotés nous rappelle nos parfaits cathares. Sadducéens :
Groupe politico-religieux du judaïsme issu de l’aristocratie, formé au IIe
siècle av. J.C et maintenu jusqu’au 1er siècle ap. J.C. Les sadducéens
respectaient strictement la Loi écrite, refusant la foi en l’immortalité de
l’âme et en la résurrection. Ils disparurent vers l’an 120.
|
|||||
|
Étude sur l’Âme et le voile dans le judaïsme |
Sam
eched |
|
2003 |
|
Petite
étude sur l’Âme, la réincarnation ou la vie après la mort. La métempsychose
dans le judaïsme et la réincarnation du temps de Jésus. Une étude sur le
voile et le credo judaïque. Une âme n’est pas seulement le
moteur de la vie ; elle incorpore également le pourquoi de
l’existence d’une chose, son sens et son objet. C’est « son identité profonde,
sa raison d’être. Tout comme “l’âme” d’une œuvre musicale est la vision du
compositeur qui confère vie et énergie aux notes jouées : les
sonorités des notes sont comme le corps qui exprime la vision et l’émotion de
l’âme qu’elles recèlent. Chaque âme est l’expression de l’intention et de la
vision divine dans la création de cette créature particulière. » Mais c’est l’âme humaine qui est
la plus complexe et la plus élevée de toutes les âmes. Nos Sages ont
dit : « Elle est appelée de cinq noms : Nefech
(âme), Roua’h (esprit), Néchama
(souffle), ‘Haya (vie) et Yé’hida
(singularité). » Les Maîtres ‘hassidiques expliquent que ces cinq
« noms » de l’âme décrivent en fait cinq niveaux ou dimensions de
l’âme. Nefech est l’âme en tant que moteur
de la vie corporelle. Roua’h est l’être
émotionnel et la « personnalité ». Néchama
est l’être intellectuel. ‘Haya est l’être suprarationel, le siège de
la volonté, du désir, de l’engagement et de la foi. Yé’hida
évoque l’essence de l’âme : son unité avec sa source qui est l’essence
singulière de Dieu. Car l’essence de l’âme humaine est « littéralement
une parcelle de Dieu d’En-haut », une partie de Dieu en nous, pour ainsi
dire. Les Maîtres ‘hassidiques parlent
de deux âmes distinctes qui donnent vie à l’être humain : une « âme
animale » et une « âme divine ». L’âme animale est mue par son
instinct de conservation et d’autosatisfaction. En cela, elle ressemble à
l’âme et à l’être de toutes les autres créatures. Mais nous possédons aussi
une « âme divine », une âme mue par le désir de se reconnecter avec
sa Source. Notre vie est l’histoire de la rivalité et de l’interaction entre
ces deux âmes, à mesure que nous luttons pour équilibrer et réconcilier nos
besoins et nos désirs physiques avec nos aspirations spirituelles, nos
inclinations égocentriques avec nos idéaux altruistes. Ces deux âmes ne
résident toutefois pas « côte à côte » dans le corps : l’âme
divine est revêtue à l’intérieur de l’âme animale, tout comme celle-ci est
revêtue à l’intérieur du corps. Cela signifie que l’âme animale, elle aussi,
reçoit sa vitalité de la « parcelle de Dieu d’En-haut » qu’elle
renferme. Si, en surface, ces deux âmes sont en conflit, dans leur essence,
elles sont compatibles. L’essence divine de l’âme humaine
est ce qui élève l’être humain au-dessus et le distingue de toutes les autres
créatures, y compris les anges. L’ange est certes plus spirituel, mais l’être
humain est plus divin. Aucune créature ne peut posséder un véritable libre
arbitre. Une créature, par définition, ne possède que – et consiste seulement
en – ce que son créateur lui a attribué ; là est sa
« nature », et chacune de ses inclinations et de ses actions seront
déterminées par cette nature. C’est seulement dans l’âme humaine que le
Créateur a mis de Sa propre essence. L’âme humaine est donc le seul être
véritablement « supranaturel » (mis à part le Créateur Lui-même),
c’est-à-dire un être qui n’est pas limité par sa propre nature ; un être
qui a la capacité de se transcender ; un être qui peut choisir de ne pas
simplement réagir à son environnement, mais agir dessus ; un être dont
les choix et les actes ont par conséquent un véritable sens. |
|||
6 F
|
flavius josÈphe |
Denis
lamour |
Edition Les Belles Lettres |
2003 |
||
|
|||||
|
FLAVIUS JOSḔPHE - HISTOIRE ANCIENNE DES
JUIFS. LA GUERRE DES JUIFS CONTRE LES ROMAINS |
Flavius
JOSÈPHE |
Edition LIDIS |
1968 |
|
Livre
de référence écrit en bon français qui regroupe les 7 petits livres écrits au
départ. C’est l’histoire des Juifs et des peuples de la méditerranée à
l’époque de Jésus. L’auteur est avec Philon d’Alexandrie, la référence de
l’époque. L'Histoire ancienne des Juifs» (qui est le gros morceau du
livre) est beaucoup plus facile à lire que la Bible ; de plus Josèphe est un
intellectuel : il fait œuvre d'historien et refuse le remplissage. Ainsi il
écrit parfois que, si les lecteurs sont intéressés par telle ou telle liste
de noms, ils les trouveront dans les Écritures saintes...
|
|||
FLAVIUS
JOSÈPHE - LES ROMAINS, LES JUIFS, ET FLAVIUS JOSÈPHE
|
Etienne Nodet
|
Edition du Cerf
|
2019
|
||
La seconde raison
tient à l'École biblique, endroit idéal pour travailler, doté d'une
remarquable bibliothèque. Elle fut fondée en 1890 par un dominicain, le Père
Lagrange, à un moment où les découvertes archéologiques ébranlaient chez les
catholiques les certitudes bibliques. Schématiquement, on peut dire que la
mentalité de l'époque avait deux caractéristiques : d'abord le
positivisme, lié aux progrès de la science, dont l'attitude de base est de ne
tenir pour vrai que ce qui est exact et vérifiable, ce qui met à mal la
véracité de la Bible ; le second trait est le romantisme – en fait une
sorte de stoïcisme – selon lequel seules les origines sont pures ; après
un âge d'or révolu, tout se dégrade, mais la science peut aider à le
reconstituer. Un mot d'Ernest Renan caractérise bien l'époque et son
projet : « Jésus avait annoncé le Royaume, mais on a vu s'installer
l'Église… » Les temps ont
changé ; la science aussi, qui se fonde maintenant sur des modèles
interprétatifs, dont la seule validité est l'efficacité. Dans le domaine
biblique au sens large, on est devenu plus sensible à la notion de
tradition : on transmet en transformant, en fonction de significations
et de préoccupations nouvelles. Il n'y a pas de point de vue neutre, ou
objectif. Dans le cas de Josèphe, son œuvre est un discours, une rhétorique.
Que veut-il prouver, et à qui ? La question est toujours à reprendre,
puisque le commentateur moderne a toujours ses propres grilles de lecture. Nous arrivons donc à
Josèphe. Qui était-il ? Qu'a-t-il fait ? Josèphe, fils de Mattathias, était un prêtre
de bonne famille, né à Jérusalem en 37, l'année de la mort de Tibère. Sa vie
se scinde en deux parties. Après une formation éclectique, d'abord haut
fonctionnaire, il fut chargé en 66 d'organiser en Galilée la résistance juive
aux Romains. Assiégé en 67, il parvint à s'échapper et se rendit à l'ennemi.
D'abord prisonnier, il devint ensuite affranchi de la famille impériale, les
Flaviens, d'où son nom de Flavius Josèphe. Lors de la guerre de Judée en 70,
les Romains l'amenèrent comme interprète-médiateur, mais on se méfiait de lui
des deux côtés. Après la guerre, pensionné à Rome et fasciné par la puissance
romaine, il se mit à écrire, avec un certain biais en faveur de ses nouveaux
patrons ; à sa mort, vers 96, il avait encore des chantiers inachevés.
Il a tout de même laissé quatre ouvrages, soit quelque 90 000
lignes : – La Guerre juive
(vers 79), où il raconte les événements qu'il a vécus de 66 à 75. Il affirme
en prologue que le véritable historien est le témoin oculaire et non le
compilateur de sources anciennes. C'est un grand principe de
l'historiographie grecque. Pourtant, il fait remonter son récit à la crise
maccabéenne, où une destruction du sanctuaire a été suivie d'une
libération ; l'histoire ancienne devient prophétie pour le présent.
C'est une perspective juive : l'historien est prophète, et
réciproquement. – Les Antiquités
juives (en 93), où pour montrer l'ancienneté de sa nation, il commence avec
Adam. Dans cet ouvrage majeur, il paraphrase toute la Bible, puis poursuit
jusqu'aux prodromes de la guerre, en 66. Il reprend donc une partie de ce
qu'il a déjà dit, ce qui permet de voir comment il travaillait. – La Vie. C'est une
autobiographie qui conclut l'ouvrage précédent. Il donne quelques
renseignements sur lui-même, mais la majeure partie du livre concerne les six
mois qu'il a passés en Galilée (en 66-67), où il décrit longuement les
conflits entre juifs, mais sans parler de l'ennemi romain. Ces souvenirs
provinciaux, publiés plus de vingt-cinq ans après les faits, ne peuvent avoir
intéressé que des juifs, pour qui la Galilée était depuis longtemps une
province essentielle. – Contre Apion (vers
95). Josèphe s'adresse aux païens, et se fait polémiste. D'une part il réfute
brillamment les critiques formulées contre les juifs, par l'Alexandrin Apion
et par d'autres ; d'autre part, il montre l'ancienneté et la réputation
de sa nation en citant non pas la Bible, mais un grand nombre d'historiens
anciens, dont la plupart sont maintenant perdus. Tout cela fait une
œuvre imposante. Quel était le propos de Josèphe ? Dans La Guerre, qui s'adresse aussi bien aux
Romains qu'aux juifs, sa thèse est simple : d'une part, il est vain de
contester la suprématie mondiale des Romains, car elle est voulue par Dieu ;
d'autre part, les juifs sont vaillants, mais leurs divisions ont causé leur
perte ; même le Dieu de Jérusalem en est las et désire se rendre à Rome.
Le Contre Apion est une œuvre apologétique ad extra, qui s'adresse aux
Romains, ou plus exactement au monde de culture grecque. Entre deux, l'ensemble
formé par Les Antiquités et La Vie est plus malaisé à situer. Officiellement,
il s'adresse au monde grec. Cependant, sa source principale est la Bible, qui
n'a pas d'autorité historique pour ce public. Il ne l'invoque jamais dans le
Contre Apion. De plus, La Vie est manifestement destinée à un public
juif : Josèphe expose sa compétence et ses titres à enseigner le
judaïsme et les récits de Galilée sont un plaidoyer pro domo où il veut
montrer, contre certains détracteurs juifs, que son seul but a toujours été
de restaurer l'unité du peuple. Mais allons plus
loin : je crois qu'après 70 il s'est posé en refondateur d'un judaïsme
centré sur Rome, mais sans perdre de vue le temple
de Jérusalem, dont il a connu une restauration au moins partielle. Ayant
constaté l'impuissance de toute monarchie juive vassale, il s'est posé en
prêtre et en pharisien, et a voulu instruire ses coreligionnaires dans tout
l'empire. Il a même voulu instaurer la coutume de l'agneau pascal à Rome. À
la même époque, une autre tentative de refondation se développait dans une
petite ville de Judée appelée Iamnia ou Yabné, au sud de Jaffa ; détail
intéressant, cette ville était depuis longtemps propriété de César, sans lien
juridique avec Jérusalem. De fait, le mouvement qui s'y développa, sous
l'impulsion de Gamaliel, un pharisien d'envergure, était strictement laïc et
avait des attaches galiléennes et même babyloniennes, bien loin de Rome. Par
la suite, l'histoire a tranché : les écoles de Judée, qui ont coupé les
liens avec le monde grec, sont devenues l'actuel judaïsme rabbinique, alors
que Josèphe n'a pas eu de postérité. De fait, il était un courtisan habile,
mais sa sensibilité religieuse était très conventionnelle et assez fade. On s'endort
souvent à la lecture. A-t-on eu raison de
l'oublier ? Que tirer de son œuvre aujourd'hui ? Cette dernière a été conservée dans les
bibliothèques publiques romaines, puis par les chrétiens de langue grecque,
qui l'honorèrent comme témoin impartial car, bien que juif, il donnait de
brèves notices assez neutres sur Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Contrairement
à une opinion usuelle, je considère ces notices comme strictement
authentiques, sans remaniement chrétien ultérieur. Plus généralement, Josèphe
fournit des renseignements de toutes natures sur son pays et sa nation ;
cependant, son mode d'emploi n'est pas toujours aisé : non seulement il
a ses propres perspectives, mais surtout il combine de manière quasi biblique
toutes les sources qu'il a pu trouver, qu'elles proviennent d'archives ou de
récits populaires. Il les agence à sa façon, sans craindre les incohérences,
ni même les contradictions ; comme en outre il a fréquenté la
littérature grecque classique, historiens et poètes, il donne à ses récits une
couleur hellénisante, dont la qualité littéraire est d'ailleurs variable. La
critique de ses méthodes de travail n'en est qu'à ses débuts. Il présente un
vaste tableau du judaïsme jusqu'à son temps, bien utile pour discerner les
origines du judaïsme actuel. Signalons trois points :– sa paraphrase
biblique est instructive, car sa source – des rouleaux hébraïques provenant
certainement de la librairie du Temple – est distincte de la Bible hébraïque
usuelle et a certaines parentés avec des fragments recueillis à Qumrân. Je
crois même qu'il est le premier à avoir rendu en grec les livres historiques,
vers 90, ce qui a d'intéressantes conséquences pour le Nouveau
Testament ;– il donne un grand nombre de traditions juives, dont
beaucoup se retrouvent dans les sources rabbiniques, ou s'y opposent. Comme
il se veut rassembleur, au-dessus de tout parti et de toute école, il
s'arrange souvent pour combiner des coutumes divergentes, d'où une rédaction
parfois confuse ; – décrivant les
diverses branches du judaïsme, il parle longuement des Esséniens, ces groupes
sectaires voulant retrouver l'Alliance à l'état pur, loin des corruptions de
Jérusalem. Ses descriptions fournissent un bon cadre d'ensemble aux
trouvailles de la mer Morte, célèbres depuis cinquante ans. Notons que le
terme « esséniens » correspond à l'hébreu hassidim, signifiant
« fidèles » ; il s'agit des disciples d'un maître, ou rabbi. À propos du christianisme, il donne bien sûr le cadre juif des
débuts, ainsi que la courte notice signalée plus haut, qu'il a recueillie à
Rome et qui est démarquée d'une confession de foi baptismale chrétienne.
Mais, dans un texte peu connu, il parle aussi de Jésus le thaumaturge et de
sa postérité juive en Judée, qui fut considérable, mais qui n'est nullement
le christianisme… Voulez-vous parler de vos travaux récents sur le « Josèphe
slavon » ? De quoi s'agit-il au juste ? Oui. De La Guerre, il avait fait une première
version en araméen, à l'usage des « barbares » orientaux, juifs ou
non. Elle est perdue, mais il dit l'avoir traduite en grec, puis s'être fait
aider de bons hellénistes pour polir le style. Le résultat, tel qu'on le
connaît depuis toujours, est une œuvre très littéraire, mais qui ignore
superbement la Bible et montre une connaissance superficielle du judaïsme.
Comme dans ses ouvrages tardifs il connaît bien l'un et l'autre, on en
conclut habituellement qu'il ne s'est intéressé à la religion que sur le
tard, bien que dans son autobiographie il affirme avoir été très précoce. En 1905, on a retrouvé une version en vieux russe (ou slavon) de
La Guerre, faite vers le XIe siècle à partir d'un texte grec. Elle est
très brève et pétrie de réminiscences bibliques et d'exégèses prophétiques.
Elle contient aussi quelques additions, parmi lesquelles des passages plutôt favorables
sur Jean-Baptiste et sur l'énorme onde provoquée par Jésus, et par ses
disciples après lui. Josèphe n'y voit encore qu'une réalité strictement juive
et il ne parle ni de Messie, ni d'accomplissement des Écritures ; il n'a
pas encore identifié le christianisme avec la fusion entre juifs et Grecs,
c'est-à-dire l'instauration d'un nouveau royaume, ou nouvelle création sans
frontières. Dans les Actes des Apôtres, la scène essentielle qui le montre
est l'incroyable visite de Pierre chez Corneille, un officier de l'armée
d'occupation. Cette étrange version en slavon a suscité d'intenses
controverses jusque dans les années 30, puis elle a été oubliée, car on la
croyait inauthentique. C'était cependant pour des raisons insuffisantes et à
mon avis il n'est pas très difficile de montrer qu'en réalité elle dérive du
premier texte grec de Josèphe (vers 75), où l'on voit bien sa fine
connaissance du judaïsme – avant l'intervention des assistants de culture
grecque, qui n'étaient pas juifs. Terminons sur un fait curieux : ce
n'est qu'après 75 et à Rome que Josèphe a fait un lien entre la postérité
juive de Jésus et les chrétiens proprement dits, incluant des incirconcis au
nom de l'Écriture, c'est-à-dire brouillant les frontières. Il est alors passé
de la bienveillance au refus navré. |
|||||
|
flavius josÈphe
– le juif de rome |
M.
HADAS – LEBEL |
Edition
FAYARD |
2002 |
|
Notre
siècle connaît-il encore Flavius Josèphe, ce prêtre né à Jérusalem qui, il y
a près de deux mille ans, fut au centre de l’affrontement entre le monde juif
et le monde romain ? Un homme au destin exceptionnel : après avoir été l’un
des chefs de la grande révolte des Juifs contre Rome en 66, il prédit
l’empire à Vespasien, se retrouva trois ans plus tard aux côtés de Titus sous
les remparts de sa ville natale assiégée et finit ses jours à Rome auprès de
ses protecteurs impériaux qui lui donnèrent un nouveau nom, Flavius. Après une formation éclectique, d'abord
haut fonctionnaire, il fut chargé en 66 d'organiser en Galilée la résistance
juive aux Romains. Assiégé en 67, il parvint à s'échapper et se rendit à
l'ennemi. D'abord prisonnier, il devint ensuite affranchi de la famille
impériale, les Flaviens, d'où son nom de Flavius Josèphe. Lors de la guerre
de Judée en 70, les Romains l'amenèrent comme interprète-médiateur, mais on
se méfiait de lui des deux côtés. Après la guerre, pensionné à Rome et
fasciné par la puissance romaine, il se mit à écrire, avec un certain biais
en faveur de ses nouveaux patrons ; à sa mort, vers 96, il avait encore
des chantiers inachevés. Il a tout de même laissé quatre ouvrages, soit
quelque 90 000 lignes : – La Guerre juive (vers 79), où
il raconte les événements qu'il a vécus de 66 à 75. Il affirme en prologue
que le véritable historien est le témoin oculaire et non le compilateur de
sources anciennes. C'est un grand principe de l'historiographie grecque.
Pourtant, il fait remonter son récit à la crise maccabéenne, où une
destruction du sanctuaire a été suivie d'une libération ; l'histoire
ancienne devient prophétie pour le présent. C'est une perspective
juive : l'historien est prophète, et réciproquement. – Les Antiquités juives (en 93),
où pour montrer l'ancienneté de sa nation, il commence avec Adam. Dans cet
ouvrage majeur, il paraphrase toute la Bible, puis poursuit jusqu'aux
prodromes de la guerre, en 66. Il reprend donc une partie de ce qu'il a déjà
dit, ce qui permet de voir comment il travaillait. – La Vie. C'est une
autobiographie qui conclut l'ouvrage précédent. Il donne quelques
renseignements sur lui-même, mais la majeure partie du livre concerne les six
mois qu'il a passés en Galilée (en 66-67), où il décrit longuement les
conflits entre juifs, mais sans parler de l'ennemi romain. Ces souvenirs
provinciaux, publiés plus de vingt-cinq ans après les faits, ne peuvent avoir
intéressé que des juifs, pour qui la Galilée était depuis longtemps une province
essentielle. – Contre Apion (vers 95).
Josèphe s'adresse aux païens, et se fait polémiste. D'une part il réfute
brillamment les critiques formulées contre les juifs, par l'Alexandrin Apion
et par d'autres ; d'autre part, il montre l'ancienneté et la réputation
de sa nation en citant non pas la Bible, mais un grand nombre d'historiens
anciens, dont la plupart sont maintenant perdus. Dans La Guerre, qui s'adresse
aussi bien aux Romains qu'aux juifs, sa thèse est simple : d'une part,
il est vain de contester la suprématie mondiale des Romains, car elle est
voulue par Dieu ; d'autre part, les juifs sont vaillants, mais leurs
divisions ont causé leur perte ; même le Dieu de Jérusalem en est las et
désire se rendre à Rome. Le Contre Apion est une œuvre
apologétique ad extra, qui s'adresse aux Romains, ou plus exactement
au monde de culture grecque. Entre deux, l'ensemble formé par Les
Antiquités et La Vie est plus malaisé à situer. Officiellement, il
s'adresse au monde grec. Cependant, sa source principale est la Bible, qui
n'a pas d'autorité historique pour ce public. Il ne l'invoque jamais dans le Contre
Apion. De plus, La Vie est manifestement destinée à un public
juif : Josèphe expose sa compétence et ses titres à enseigner le
judaïsme et les récits de Galilée sont un plaidoyer pro domo où il
veut montrer, contre certains détracteurs juifs, que son seul but a toujours
été de restaurer l'unité du peuple. Mais allons plus loin : je crois
qu'après 70 il s'est posé en refondateur d'un judaïsme centré sur Rome, mais sans perdre de vue le temple de Jérusalem,
dont il a connu une restauration au moins partielle. Ayant constaté
l'impuissance de toute monarchie juive vassale, il s'est posé en prêtre et en
pharisien, et a voulu instruire ses coreligionnaires dans tout l'empire. Il a
même voulu instaurer la coutume de l'agneau pascal à Rome. À la même époque,
une autre tentative de refondation se développait dans une petite ville de
Judée appelée Iamnia ou Yabné, au sud de Jaffa ; détail intéressant,
cette ville était depuis longtemps propriété de César, sans lien juridique
avec Jérusalem. De fait, le mouvement qui s'y développa, sous l'impulsion de
Gamaliel, un pharisien d'envergure, était strictement laïc et avait des
attaches galiléennes et même babyloniennes, bien loin de Rome. Par la suite, l'histoire a
tranché : les écoles de Judée, qui ont coupé les liens avec le monde
grec, sont devenues l'actuel judaïsme rabbinique, alors que Josèphe n'a pas
eu de postérité. De fait, il était un courtisan habile, mais sa sensibilité
religieuse était très conventionnelle et assez fade. Cette dernière a été
conservée dans les bibliothèques publiques romaines, puis par les chrétiens
de langue grecque, qui l'honorèrent comme témoin impartial car, bien que
juif, il donnait de brèves notices assez neutres sur Jésus-Christ et
Jean-Baptiste. Contrairement à une opinion usuelle, je considère ces notices
comme strictement authentiques, sans remaniement chrétien ultérieur. Plus généralement, Josèphe fournit des
renseignements de toutes natures sur son pays et sa nation ; cependant,
son mode d'emploi n'est pas toujours aisé : non seulement il a ses
propres perspectives, mais surtout il combine de manière quasi biblique
toutes les sources qu'il a pu trouver, qu'elles proviennent d'archives ou de
récits populaires. Il les agence à sa façon, sans craindre les incohérences,
ni même les contradictions ; comme en outre il a fréquenté la
littérature grecque classique, historiens et poètes, il donne à ses récits
une couleur hellénisante, dont la qualité littéraire est d'ailleurs variable.
La critique de ses méthodes de travail n'en est qu'à ses débuts. Il présente
un vaste tableau du judaïsme jusqu'à son temps, bien utile pour discerner les
origines du judaïsme actuel. Signalons trois points : – sa paraphrase biblique est
instructive, car sa source – des rouleaux hébraïques provenant certainement
de la librairie du Temple – est distincte de la Bible hébraïque usuelle et a
certaines parentés avec des fragments recueillis à Qumrân. Je crois même qu'il
est le premier à avoir rendu en grec les livres historiques, vers 90, ce qui
a d'intéressantes conséquences pour le Nouveau Testament ; – il donne un grand nombre de
traditions juives, dont beaucoup se retrouvent dans les sources rabbiniques,
ou s'y opposent. Comme il se veut rassembleur, au-dessus de tout parti et de
toute école, il s'arrange souvent pour combiner des coutumes divergentes,
d'où une rédaction parfois confuse ; – décrivant les diverses branches du
judaïsme, il parle longuement des Esséniens, ces groupes sectaires voulant
retrouver l'Alliance à l'état pur, loin des corruptions de Jérusalem. Ses
descriptions fournissent un bon cadre d'ensemble aux trouvailles de la mer
Morte, célèbres depuis cinquante ans. Notons que le terme « esséniens »
correspond à l'hébreu hassidim, signifiant « fidèles » ; il
s'agit des disciples d'un maître, ou rabbi. À propos du christianisme, il donne
bien sûr le cadre juif des débuts, ainsi que la courte notice signalée plus
haut, qu'il a recueillie à Rome et qui est démarquée d'une confession de foi
baptismale chrétienne. Mais, dans un texte peu connu, il parle aussi de Jésus
le thaumaturge et de sa postérité juive en Judée, qui fut considérable, mais
qui n'est nullement le christianisme… De La Guerre, il avait fait une
première version en araméen, à l'usage des « barbares » orientaux,
juifs ou non. Elle est perdu, mais il dit l'avoir
traduite en grec, puis s'être fait aider de bons hellénistes pour polir le
style. Le résultat, tel qu'on le connaît depuis toujours, est une œuvre très
littéraire, mais qui ignore superbement la Bible et montre une connaissance
superficielle du judaïsme. Comme dans ses ouvrages tardifs il connaît bien
l'un et l'autre, on en conclut habituellement qu'il ne s'est intéressé à la
religion que sur le tard, bien que dans son autobiographie il affirme avoir
été très précoce. En 1905, on a retrouvé une version en
vieux russe (ou slavon) de La Guerre, faite vers le XIe siècle à
partir d'un texte grec. Elle est très brève et pétrie de réminiscences
bibliques et d'exégèses prophétiques. Elle contient aussi quelques additions,
parmi lesquelles des passages plutôt favorables sur Jean-Baptiste et sur
l'énorme onde provoquée par Jésus, et par ses disciples après lui. Josèphe
n'y voit encore qu'une réalité strictement juive et il ne parle ni de Messie,
ni d'accomplissement des Écritures ; il n'a pas encore identifié le
christianisme avec la fusion entre juifs et Grecs, c'est-à-dire l'instauration
d'un nouveau royaume, ou nouvelle création sans frontières. Dans les Actes
des Apôtres, la scène essentielle qui le montre est l'incroyable visite
de Pierre chez Corneille, un officier de l'armée d'occupation. Cette étrange
version en slavon a suscité d'intenses controverses jusque dans les années
30, puis elle a été oubliée, car on la croyait inauthentique. C'était
cependant pour des raisons insuffisantes et à mon avis il n'est pas très
difficile de montrer qu'en réalité elle dérive du premier texte grec de
Josèphe (vers 75), où l'on voit bien sa fine connaissance du judaïsme – avant
l'intervention des assistants de culture grecque, qui n'étaient pas juifs.
Les
Esséniens, les Sadducéens, le désert, le gouverneur de Galilée, Vespasien,
Jérusalem, Rome, Alexandrie, Massada, Sion, et un condensé de la vie
militaire religieuse et économique du Moyen Orient il y a 2000 ans. |
|||
6 I
|
IESCHOUA - La descente de Dieu |
Christiama
NIMOSUS |
Edition
Ediru |
1994 |
||
Par contre, Ieschoua confrontait les prêtres juifs qu'il accusait d'hypocrisie parce qu'ils n'observaient pas leurs propres lois : les lois hébraïques qu'ils enseignaient au peuple. De plus, il agaçait le roi Hérode
et sa famille dont il dénonçait la faible vertu. Comment un roi peut-il être
respecté quand il se vautre dans la luxure que l'on dénonce ouvertement?
Finalement, les Romains ont dû intervenir à cause des désordres que ses
positions créaient dans la population. Notre Fils de l'Homme enseignait
peut-être le pacifisme mais il n'avait pas son pareil pour provoquer les
trois pouvoirs en place. Les foules enthousiastes
reconnaissaient en lui volontiers des pouvoirs magiques, et ceci contribua à
augmenter sa popularité. Il s'est construit un tel mythe autour de sa
personne, que nombreux étaient les gens qui cherchaient à le confronter,
autant dans son discours que dans ses prétendus miracles. Maniant la parole
avec grâce, finesse, poésie et humanité, il parvenait toujours à se sortir
des pièges qu'on lui tendait, sauf lorsqu'il s'arrogeait l'autorité divine
que les prêtres lui contestaient en l'accusant de blasphémer. Il refusait
souvent de confirmer être l'auteur de miracles et catégoriquement d'en
produire sur demande. Pourtant, il voulait que les gens attribuent cette
« magie » à Dieu, avec qui il s'identifiait ouvertement, et il en
jouait pour gagner des adeptes. Ceci eut la fâcheuse conséquence
de diviser son auditoire. En effet, ceux qui avaient bénéficié de ses
bienfaits étaient vus comme « bénis de Dieu », et les autres comme
« rejetés » ou « indignes de la bonté de Dieu ».
Cette partie de la foule voyait ainsi une contradiction et de l'injustice
dans son enseignement qui prétendait à l'amour et au pardon de Dieu pour
tous. Comment Dieu pouvait-il être un Père d'amour infiniment bon sans
accorder ses bienfaits équitablement à tous? Quoi qu'il en soit, son message
de paix, d'amour et de pardon fut si puissant qu'il a continué à être honoré
depuis maintenant vingt siècles. En effet, en se laissant crucifier, il
instituait le pouvoir de la victime. Avant lui, la notion de victime
n'existait pas. Le châtiment était la Justice de Dieu. Après lui, quiconque
est puni devient une victime qui subit un sort injuste. Pis encore, chaque
infortuné s'autorise, à revendiquer pour qu'on le libère de son infortune
puisque chacun a droit au pardon en vertu de la bonté infinie de Dieu le
Père. Si rien n'est impossible à Dieu, son amour ne devra-t-il pas s'exprimer
à tous par des bontés? Ieschoua enseigne l'amour de Dieu, le pardon et la non-violence. Il applique
ces principes à sa vie intégralement en donnant l'exemple d'une grande
générosité. Parallèlement, il provoque les autorités en place de telle sorte
qu'on le crucifie. Vu ainsi, Ieschoua est un raté
provocateur qui a été justement châtié. Mais si on lui accorde l'immunité
divine, c'est non seulement un innocent qu'on a crucifié, mais on a commis
l'irréparable erreur de ne pas avoir reconnu Dieu en personne et son
autorité. C'est dans le supplice infligé qu'il prend tout son pouvoir. Et
chaque fois que l'on blesse un innocent, c'est son histoire que l'on répète. Mais peut-on véritablement
prétendre que le pardon de Dieu nous innocente? En fait, Dieu nous reconnaît
coupables, mais il suspend l'exécution du châtiment pour ne pas nous donner
le pouvoir de la victime. Ce pouvoir, il se le garde pour lui tout seul.
Voilà son génie! Toujours coupables, jamais châtiés. Avec un Dieu comme
celui-là, nous n'avons aucun autre pouvoir que celui d'aimer, jamais celui de
nous venger, puisque nous sommes toujours pardonnés. Si une victime réclame
vengeance, elle met alors le doigt dans un engrenage qui, à son tour, lui
refusera le pardon de ses erreurs à venir. Pour que cette logique
fonctionne, Ieschoua doit nécessairement
démontrer sa nature divine. D'où miracles sur miracles, couronnés de la
résurrection de son corps, ultime preuve de son autorité divine. Cette
logique est si parfaite que la vérité devient secondaire. La nécessité crée
la « vérité ». Comme Martin Scorsese nous le fait remarquer dans
son film La dernière tentation du Christ, à la limite, le mythe de
Jésus est si puissant, qu'il peut parfaitement se passer de Ieschoua lui-même, et que, s'il était vraiment Dieu et
capable de se sauver de la croix, c'est par pure soif de notoriété
individuelle qu'il a choisi d'incarner personnellement le rôle du Christ et
qu'il s'est laissé mourir sur la croix. À cette époque de notre histoire, le
mythe du Christ se devait de naître. La personne physique que l'Histoire
(en marche) choisirait pour l'incarner était secondaire. Il importe donc assez peu que Ieschoua ait été parfait ou non. Ce qui importe c'est que
notre foi en sa nature divine valide tout le processus de la chrétienté
visant à mettre un frein à la violence, à la vengeance et aux châtiments.
Désormais, il importe d'éviter à tout prix de mettre l'autre dans une
position de victime. Ce serait lui donner un pouvoir divin : celui de
nous pardonner ou de nous châtier, le pouvoir de la victime. |
|||||
|
initiation à la kabbale hébraïque |
A.
D. grad |
Edition
du Rocher |
1990 |
|
Kabbale … mot mystérieux véhiculé par les Hébreux, qui ouvre les
sentiers d’une spiritualité débordant le lit de l’hébraïsme pour atteindre
l’Universel. C’est une science plutôt complexe qui regroupe plusieurs
disciplines ésotériques, en ce sens elle est à la fois fondamentale, occulte,
expérimentale, déductive, humaine, narrative, naturelle et appliquée, de plus
elle est non systématique et ne peut donc être exposée selon les impératifs de
notre structure mentale courante. La
Kabbale comporte une gamme étendue de définitions. On l’appelle tour à tour,
« la Sagesse d’en haut », « la mathématique sacrée »,
une « mystique du langage », une « expérience de
l’Être ». En
fait le mot kabbale vient de l’hébreu qabbâlâh, qui
signifie très précisément : « réception,
accueil » Pour
les chercheurs en kabbale, le mot signifie surtout « Sagesse secrète ». Les
maîtres de la kabbale hébraïque sont : Isaac l’aveugle et Yehoudah ben barzilaï,
tous deux vécurent et développèrent la Kabbale au Moyen-Âge d’abord en
Espagne puis en France près de Beaucaire. La tradition juive fait remonter
les premiers écrits de la kabbale au 2e siècle avec le
« prince des kabbalistes » : Rabbi Siméon bar Yo’hai appelé aussi la Lampe Sainte et qui serait
l’auteur du Zohar « Le livre de la Splendeur » qui renferme
la « Sagesse secrète » qui fut révélé à Moise sur le Mont Sinaï en
marge de la Loi écrite. Le
Zohar nous apprend aussi que cette Sagesse secrète était gravée sur un livre
donné à Adam, livre descendu du ciel et remis à Adam par le Maître des
mystères précédé de trois messagers. Adam aurait été donc le premier
kabbaliste, puisqu’il donne des noms aux animaux, aux oiseaux et aux bêtes
sauvages, car pour nommer, il faut une connaissance des Nombres. Au sommaire de cet ouvrage : L’hébreu
sacré - La Bible - les sephirot - le
Zohar - le Cantique des cantiques - Isaac et
Jésus - Tuer Dieu, est ce
possible ? - Identité de la mère - Tout dépend
de la femme - Principes kabbalistique - le premier
mot de la Bible ou l’Alliance de feu - Et su Abel était l’âme de
Caïn - la circoncision - la virginité -
Planète Arqa - le Golem et son secret - A chacun son
mythe - Logos et Davar
- Un cas asymptotique de mythologisation
- le mythe du hasard - L’ordre du vivant - Deux
mythes métopages - La quête de l’Ineffable - La
kabbale de la Lumière - Kabbale et Franc-maçonnerie -
Le carré Rotas - La kabbale de l’or philosophal
- liturgie fuégienne - |
|||
6 J
|
JÉRÉMIE |
André
NEHER |
EDITION
DU SEUIL |
1998 |
|
Jérémie. Six cents ans avant l’ère chrétienne, quel fut
l’itinéraire du prophète Jérémie ? Cet homme de vigie, appelé par Dieu
et pourtant abandonné par Lui, fut exposé toute sa vie à l’angoisse d’une
expérience aveuglante. Juif, il l’était religieusement, avec ce sentiment
irréductible que l’univers répondait à un destin organisé. Vivant à une
époque de catastrophe totalitaire, il voulut de toutes ses forces préserver
du naufrage les valeurs spirituelles de l’homme et c’est sans doute ce qui
rend éternelle sa philosophie de l’histoire et si proche de notre temps son
enseignement. Imaginez! à son
corps défendant il fut prophète durant cinquante ans. Cinquante ans à
prophétiser sans en avoir le goût. Aussi se plaignit-il beaucoup, sans
pourtant jamais faillir à la tâche. C'est en son "honneur" que l'on
inventa la parole "jérémiades". Vous avez entendu qu'on dise à
quelqu'un: "Cesse donc tes jérémiades"? Il se lamenta tellement
qu'on lui attribua faussement le livre biblique des Lamentations. Voici donc l'histoire du prophète qui aimait
se lamenter... et qui commença fort jeune. Jérémie était un gamin quand Dieu
lui révéla: "Avant de te former au ventre maternel, je t'ai connu;
avant que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré; comme prophète des nations
je t'ai établi". Il était un jouvenceau tranquille et pieux. Un
jour, qu'il était tout absorbé dans ses prières, Dieu s'adressa à lui et lui
dit d'un ton grave: " Jérémie, mon petit, tu vas aller parler à
ma place et en mon nom: au Roi et aux grands du pays". Jérémie, qui
avait entendu - car il arrive que Dieu parle pour se faire comprendre- lui répondit
sur le même ton: " Un instant Monseigneur! Je ne suis qu'un muchacho !
Je ne prendrai pas la parole en ton nom. À mon âge? qui me croira? on se
moquera de moi, on dira que je n'ai pas le nombril sec, et l'on m'enverra
paître... Point." Et Dieu lui dit, plus fort encore: "Va ! Je
serais avec toi ". Pauvre Jérémie, il entreprenait une carrière
qui ne serait pas de tout repos, laissez-moi vous dire. Cette idée, aussi, de
prier si jeune, et avec ferveur. Sans doute que l'Esprit du Seigneur - qui
avait beaucoup à faire en ce temps-là pour sauver les meubles - lui avait mis
cela dans la tête et dans le coeur, intentionnellement. Le Prophète s'en
repentit parfois plus tard, mais trop tard: il avait posé le pas tragique,
celui qui le faisait entrer dans le jeu dangereux de Dieu. Et il n'eut plus
de repos. En effet, un jour,
Jérémie se plaignit devant Dieu: "Tu m'as séduit, Havhé, et je me
suis laissé séduire; tu m'as maîtrisé: tu as été le plus fort (....) Je me
disais: je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son Nom; alors
c'était en mon coeur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je
m'épuisais à le contenir, je ne pouvais le supporter..." Sa désespérance
alla si loin, un jour, qu'il cria à Dieu un cri résonnant comme un blasphème
affreux (pour un homme pieux, il ne mâchait pas ses mots): Pauvre Jérémie! Il
était peut-être "lamenteux", mais il se
lamentait pour quelque chose qui ne faisait pas de sa vie une randonnée
bourgeoise ou un pique-nique amoureux. Il était de nature timide, tranquille,
sans prétention aux yeux des hommes - surtout pas celle d'être prophète! Fort
probable que Dieu l'embaucha parce qu'il n'intimidait personne a priori :
on serait d'autant plus surpris de ses paroles quand il proclamerait à voix
forte. Pensez donc, Dieu lui refusa même l'être complémentaire que d'autres
prophètes eurent dans leurs épreuves: une épouse assortie qui le soutint. À
peine à vingt ans, Jérémie fut condamné au célibat perpétuel; or il ne devait
mourir que vers l'âge de soixante-dix ans. Dieu lui avait dit, un soir, où
probablement il cherchait une épaule pour s'épancher: Ne prends pas femme;
n'aie en ce lieu ni fils ni fille! Car ainsi parle Yavhé sur les fils et les
filles qui vont naître en ce lieu, sur les mères qui les enfanteront et sur
les pères qui les engendreront en ce pays: "Ils mourront de male mort,
sans avoir pleurs ni sépulture; ils serviront de fumier sur le sol; ils
finiront par l'épée et la famine, et leurs cadavres seront la pâture des
oiseaux et des bêtes sauvages" Durant ses cinquante
ans de ministère, Jérémie connut cinq rois et un gouverneur. Il fut témoin de
quatre invasions, subit le long siège de Jérusalem, où il fut emprisonné. Il
mourut vieux, en exil volontaire en Égypte, d'une mort dont on ne connaît pas
les circonstances. Comme prophète, Jérémie traita surtout avec trois rois -
les trois rois qu'un prof d'Écriture qualifie ainsi: Josias
"l'énergique", Jéchonias "le rebelle" et Sédécias
"le faible". Sa carrière débuta tout de même assez bien. Le peuple
était pécheur invétéré, et Jérémie devait en dénoncer l'horreur. Mais Josias "l'énergique"
avait déjà initié le mouvement de réforme. Il eut du cran devant Dieu et
devant les hommes, le jeune roi, qui entreprit de purifier le pays à grand
renfort de moyens, pulvérisant les idoles sous ses pieds. Jérémie se joignit
à lui. Les deux étaient à peu près du même âge, et ils collaborèrent
fermement durant dix-huit ans. Jérémie, le craintif par nature, commença donc
son ministère soutenu par le roi et par la Parole de Yavhé. Il parla même
avec une éloquence qui surprit tout le monde. Il disait que Yavhé lui avait
touché la bouche, en étendant la main, et lui avait dit: "Voilà, je
mets en ta bouche mes paroles. Regarde, aujourd'hui, je t'établis sur les
nations et sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour exterminer et
démolir, pour bâtir et planter». De la haute prophétie qui consiste à
parler au nom de Dieu! Quel programme, mes
amis: nettoyer à fond, en arrachant, renversant, exterminant et démolissant;
mais, tout cela, pour construire, bâtir la vie, planter la vie. Le péché
mignon du peuple, qui surabondait, était l'idolâtrie. Josias et Jérémie
avaient été témoins de la dépravation du royaume du nord, Israël, et de sa
reddition aux mains de l'étranger. À la lumière de cette actualité, les deux
hérauts de la justice et de la fidélité parlèrent avec fermeté à Juda, le
royaume du sud. Hélas! à 39 ans, Josias périt dans une guerre qui ne le
concernait même pas. Jérémie se fendit d'une élégie que la Bible célèbre et
présente comme modèle et règle pour les deuils futurs. Dès lors, isolé,
esseulé, Jérémie dut exercer son labeur comme franc-tireur, sous le régime du
nouveau roi, Jéchonias "le rebelle" qui ne lui rendit pas la tâche
facile. Jéchonias ne suivit pas les traces de son père; "il fit ce
qui déplût à Dieu». Or quand le roi "faisait" ainsi, le peuple
"faisait" aussi: il optait pour la facilité et le luxe des cultes
païens. Et le peuple incluait, comme en ses tristes entrailles, les prêtres
et les hordes de faux-prophètes qui flattaient les deux, et le roi et le
peuple, pour se gagner leurs faveurs. On peut dire que Jérémie eut alors
beaucoup de fil à retorde. Il vitupérait à pleine voix au nom du Seigneur
Yavhé: Le peuple refusa d'écouter la voix du Prophète qui entrait en
compétition avec celle des prêtres, eux-mêmes vendus au culte des idoles.
Jérémie leur criait la voix de Dieu. Comment pouvez-vous dire: "Nous
sommes sages et nous avons la Loi de Yavhé!" Vraiment, c'est en mensonge
que l'a changée le calame mensonger des scribes! Les sages sont honteux,
consternés et pris au piège. Voilà qu'ils ont méprisé la voix de Yavhé! Eh
bien, leur sagesse, à quoi leur sert-elle? Ce fut une étape bien
souffrante pour Jérémie, qui souffrait de la souffrance de son peuple. Et
comme toujours, le pauvre, il se lamentait haut et fort: André Neher (1914-1988), est l’un des grand
penseurs juifs de ce siècle, il a recomposé depuis l’intérieur de la
Bible, en s’appuyant sur des situations historiques mouvantes et complexes,
mais sans jamais l’arracher à sa source personnelle et imprévisible, la vie
du plus tragique des prophètes : celui qui avait accepté d’assumer
devant Dieu, la plus haute souffrance que l’homme puisse éprouver : Jérémie |
|||
|
jÉrusalem la sainte |
Gérard israël |
Edition Odile Jacob |
2001 |
||
Selon l’Ancien Testament, David
décida de faire de Jérusalem sa résidence et la capitale de son pays. Le nouveau
roi y fit apporter l’Arche d’Alliance depuis Qiryat
Ye’crim (Lieu saint de l’époque, à l’ouest de
Jérusalem) et l’installa dans un tabernacle neuf. L’arche d’Alliance est le
symbole de la révélation divine. Ce précieux coffre contient les deux tables
de pierre sur lesquelles Yahvé, le dieu des Juifs, a inscrit la charte de
l’alliance conclue avec son peuple par l’intermédiaire de Moïse. Le document
est évoqué dans la bible principalement par les dix commandements. Il fit
bâtir un nouveau palais et renforça les fortifications de la ville. Le fils
et successeur de David, Salomon, poursuivit le développement de la ville. Il
fit construire une muraille et de nombreux bâtiments d’une splendeur inconnue
jusqu’alors en Israël : le Temple et le nouveau palais royal, entouré
d’un mur. Le palais, érigé sur des terrasses
successives, comprenait une maison, construite avec des poutres de cèdre et
des piliers apportés des forêts du Liban, une salle du trône, des
appartements princiers et une prison. Surélevés par rapport au nouveau
palais, les cours et les bâtiments du Temple furent construits en cèdre et en
pierre. Le beau-père de Salomon, le roi de Tyr, en Phénicie, lui procure des
matériaux de construction, des architectes et des ouvriers qui viennent
compléter la main d’œuvre juive. Dans la cour se trouvait l’autel des
sacrifices et une "mer en fusion" ou réservoir à eau des
purifications en bronze. Aujourd’hui le seul vestige de ce temple est le mur
des lamentations. Jérusalem poursuivit son expansion après le règne de Salomon jusqu’à ce que les dix tribus du nord d’Israël se dégagent de la souveraineté de la maison de David pour former le royaume d’Israël. La ville, désormais capitale des tribus de Juda et Benjamin, déclina fortement. Menacée pendant deux siècles par des sièges et des expéditions militaires, ce n’est que sous les règnes du roi Uzziah de Judée (783-742 av. J.-C.) et de son fils Jotham (742-735 av. J.-C.) que la ville put retrouver son prestige ancien. De cette période à l’ascension de la puissante famille Maccabée, environ six siècles plus tard, l’histoire de Jérusalem se confond étroitement avec celle du peuple juif. Sous les Maccabées, Jérusalem entra dans une ère de prospérité sans précédent et devint la Ville sainte du judaïsme et le grand lieu de pèlerinage du monde juif. |
|||||
|
JḖRUSALEM,
TROIS FOIS SAINTE |
M. A. Ouaknin – Philippe Markiewicz –
Mohammed Taleb |
Edition Desclée de Brouwer |
2016 |
|
Cette collection dirigée
par Olivier Germain-Thomas, s’adresse à tous ceux qui veulent voyager en
recherche de sens, pour des rencontres spirituelles, culturelles ou
philosophiques. « Elle s’adresse, confie Olivier Germain-Thomas, à tous ceux,
qui las des sentiers battus, veulent toucher les racines spirituelles des
lieux qu’ils visitent, vivre intensément les rituels, comprendre les
relations à l’amour, à la mort ou à l’éternité. » Deux ouvrages ont déjà été
publiés dans cette collection, l’un consacré au Mont Athos, l’autre à
l’Egypte. Pour cette rencontre
avec Jérusalem, cité au cœur des spiritualités du judaïsme, de l’islam et du
christianisme, trois regards sont proposés au lecteur, ceux de Marc-Alain
Ouaknin, rabbin et docteur en philosophie, Philippe Markiewicz,
moine bénédictin qui dirige la revue Arts sacrés et Mohammed Taleb, auteur
spécialiste d’écopsychologie, de droit des peuples
et de spiritualité. Il ne s’agit pas d’un dialogue entre les auteurs mais de
trois contributions juxtaposées. Cependant, ces regards indépendants sur la
ville « trois fois sainte » se croisent nécessairement et converge vers un
même idéal de paix. Laissant de côté la
dimension politique de la cité de Jérusalem, nos trois auteurs explorent les
spiritualités qui rayonnent à partir de cette cité au fil des temps et malgré
les vicissitudes traversées. Il s’agit de témoignages à la fois personnels et
érudits, souvent éclairants, parfois bouleversants, de rapports singuliers
avec un lieu sacré. Les titres des textes des trois auteurs sont déjà une
indication de ce rapport auquel le lecteur s’associe aisément : Lire (à)
Jérusalem pour Marc Alain Ouaknin – Sion, ma mère par Philippe Markiewicz – Fragments d’histoire et de spiritualité
de la Jérusalem musulmane par Mohammed Taleb. Marc Alain Ouaknin
nous dit que « Jérusalem nous arrache à l’existence ordinaire et nous porte
vers un ailleurs, une autre manière d’être et de vivre… ». Et de s’interroger
: Qu’est-ce qu’une ville ? Or, poursuit Marc Alain Ouaknin, le Talmud indique
que « la vitalité d’une ville passe par trois éléments fondamentaux, trois
symboles essentiels, trois piliers qui en soutiennent la dimension humaine et
humanisante : la ruine, le pont et la tombe… ». Il indique par la
ruine que « La ville ne peut être inaugurale, elle ne peut pas s’auto-fonder.
Il y a toujours quelque chose qui la précède. » Le mot ‘ir, qui en hébreux désigne la ville, signifie
«éveil», « sortir du sommeil ». D’où le pont qui évoque « l’éveil des
consciences les unes par les autres ». La tombe, quant à
elle, néfech en hébreux ou « âme de
vie » conduit Marc-Alain Ouaknin à évoquer le souvenir, la Shoah, les
cimetières de Jérusalem mais aussi les noms de Jérusalem depuis Our-Salim ou
Ur-Salim au XIIIe siècle avant JC jusqu’à l’actuelle Yerouchalayim
qui tous évoquent la cité de la paix. C’est de sa
rencontre avec Jérusalem que nous parle Philippe Markiewicz.
Une rencontre complexe avec une ville complexe, une ville à mystères. Une
rencontre qui conduit le lecteur vers une traversée des formes. Il s’agit de
passer de l’architecture de pierre à une architecture intérieure, d’un
pèlerinage physique à un pèlerinage interne, de la cité temporelle à la cité
intemporelle. Mohammed Taleb nous
intéresse à « La place de Jérusalem dans la conception du monde et la
conscience spirituelle de l’islam ». « Ce à quoi j’aspire, dit-il au lecteur,
à travers les pages qui suivent, c’est de mettre en pleine lumière l’islamité
et l’arabité de la cité des prophètes, sa présence dans les lettres
spirituelles de l’islam, sa radiance comme pôle de sacralité et d’excellence.
» Al-Qods, nom arabe de Jérusalem, fait partie des villes saintes de
l’islam. Moins importante que La Mecque ou Médine, elle n’en est pas moins
porteuse de sens, notamment métaphysique. « Jalon entre Terre et Ciel » elle
est aussi « lieu d’orientation de la première prière musulmane », prière
entendue comme ascension. Mohamed Taleb aborde
aussi la place de Jésus, fils de Myriam, dans l’islam comme « lien entre Al-Qods et la fin des temps ». Il remarque que «
Pleinement humain, le Jésus coranique entretient avec la sphère divine une
relation étroite ». Le Coran lui donne « une dimension transcendantale (mais
non divine) qui fait de Jésus un élément essentiel de l’eschatologie
islamique » et « un signe de la fin des temps ». Ce livre,
passionnant, et riche de ses interrogations, invite à une alliance aussi nécessaire
qu’inévitable entre Orient et Occident, alliance que nous devons d’abord
réaliser en nous afin de contribuer à sa réalisation physique et temporelle. |
|||
|
JÉrusalem traditionnelle et initiatique |
Jacques
thomas |
Edition
J. Cyrille godefroy |
1995 |
||
-
Le mont Moriah ou mont du Temple. Il y a 3 000 ans, c’est là qu’il y
avait temple de Salomon qui abritait, selon la bible, l’arche d’alliance et
les tables de la loi. -
Le Saint-Sépulcre par les Chrétiens car c’est là que se serait fait crucifier
le Christ et c’est là que se trouverait son tombeau.- Mais ce mont, qui se
situe dans la vieille ville, est aussi appelé Esplanade des mosquées car ce
sont les musulmans qui ont édifié au VIIe siècle les mosquées Al-Aqsâ et le Dôme du Rocher. C’est de cet endroit précis
que le prophète Mahomet se serait envolé vers dieu sur un cheval ailé ce qui
fait de Jérusalem le troisième lieu saint de l’Islam. Voilà
donc pourquoi Jérusalem est une ville trois fois sainte. Cela dit, son
origine est antérieure à l’apparition des trois religions Le site
de Jérusalem fut habité dès la préhistoire. Les premiers habitants en furent
chassés entre 5 000 et 4 000 av. J.-C., par un peuple appelé les
Cananéens dans l’Ancien Testament. Les envahisseurs, un peuple de différentes
composantes où les Jébuséens dominaient, tombèrent sous la domination
égyptienne au XVe siècle av. J.-C., au cours des conquêtes du roi Touthmôsis
III. Puis, en 1250 environ av. J.-C., les Hébreux commencèrent la conquête de
Canaan. Pourtant, Jérusalem, abritée derrière de remarquables fortifications,
ne tomba que deux cents ans plus tard, lorsque David s’en empara quelques
années après avoir reçu l’onction et avoir été sacré roi
d’Israël. Selon
l’Ancien Testament, David décida de faire de Jérusalem sa résidence et la
capitale de son pays. Le nouveau roi y fit apporter l’Arche d’Alliance depuis
Qiryat Ye’crim (Lieu
saint de l’époque, à l’ouest de Jérusalem) et l’installa dans un tabernacle
neuf. L’arche d’Alliance est le symbole de la révélation divine. Ce précieux
coffre contient les deux tables de pierre sur lesquelles Yahvé, le dieu des
Juifs, a inscrit la charte de l’alliance conclue avec son peuple par
l’intermédiaire de Moïse. Le document est évoqué dans la bible principalement
par les dix commandements. Il fit bâtir un nouveau palais et renforça les fortifications
de la ville. Le fils et successeur de David, Salomon, poursuivit le
développement de la ville. Il fit construire une muraille et de nombreux
bâtiments d’une splendeur inconnue jusqu’alors en Israël : le Temple et
le nouveau palais royal, entouré d’un mur. Le palais, érigé sur des terrasses
successives, comprenait une maison, construite avec des poutres de cèdre et
des piliers apportés des forêts du Liban, une salle du trône, des
appartements princiers et une prison. Surélevés par rapport au nouveau
palais, les cours et les bâtiments du Temple furent construits en cèdre et en
pierre. Le beau-père de Salomon, le roi de Tyr, en Phénicie, lui procure des
matériaux de construction, des architectes et des ouvriers qui viennent
compléter la main d’œuvre juive. Dans la cour se trouvait l’autel des
sacrifices et une "mer en fusion" ou réservoir à eau des
purifications en bronze. Aujourd’hui le seul vestige de ce temple est le mur
des lamentations. Jérusalem
poursuivit son expansion après le règne de Salomon jusqu’à ce que les dix
tribus du nord d’Israël se dégagent de la souveraineté de la maison de David
pour former le royaume d’Israël. La ville, désormais capitale des tribus de
Juda et Benjamin, déclina fortement. Menacée pendant deux siècles par des sièges
et des expéditions militaires, ce n’est que sous les règnes du roi Uzziah de Judée (783-742 av. J.-C.) et de son fils Joatham (742-735 av. J.-C.) que la ville put retrouver
son prestige ancien. De cette période à l’ascension de la puissante famille
Maccabée, environ six siècles plus tard, l’histoire de Jérusalem se confond
étroitement avec celle du peuple juif. Sous les Maccabées, Jérusalem entra
dans une ère de prospérité sans précédent et devint la Ville sainte du
judaïsme et le grand lieu de pèlerinage du monde juif. La
conquête de Jérusalem par les Romains, sous le général Pompée le Grand, en 63
av. J.-C., n’entraîna pas de dégâts matériels importants. La ville atteignit
sa plus grande prospérité sous le règne de Hérode le Grand, reconnu roi des
Juifs par les Romains. En plus d’une reconstruction somptueuse et coûteuse du
Temple, le roi Hérode entreprit la construction d’un nouveau palais, à
l’ouest de la ville, d’un hippodrome, d’un théâtre et d’un réservoir
important. Moins d’un siècle plus tard, pourtant, pendant une rébellion juive
contre l’autorité romaine, Titus, fils de l’empereur romain Vespasien, prit
et rasa la ville en 70 apr. J.-C. Hérode, avait été le dernier roi d’une
Judée indépendante mais "alliée et amie du peuple romain". Les
embellissements apportés au Temple symbolisaient sa volonté politique
autonome. Aussi, la population supporte-t-elle mal le passage à une
administration romaine directe, après sa mort, en 4 avant notre ère. Face aux
difficultés que posent la succession du roi, Auguste décide en effet, en 6 de
notre ère, de transformer la Judée en province. Dès lors, bien que Rome
tolère la religion juive, des frictions apparaissent, car les juifs n’ont
jamais accepté leur annexion par un peuple païen. En 66 se déclenche une première
révolte et c’est une vraie guerre qui débute engagée par un État juif
politiquement constitué. Le 9 du mois ab de l’année 3830 depuis la Création,
selon le calendrier juif, soit le 29 août 70 de l’ère chrétienne, "un
soldat, sans attendre les ordres, sans être effrayé par une telle initiative,
mû par une sorte d’impulsion surnaturelle", écrit l’historien juif
Flavius Josèphe dans sa Guerre des juifs, met le feu au second temple de
Jérusalem. Jérusalem est tombée. La destruction du sanctuaire unique de Yahvé,
Dieu des juifs, met quasiment fin à quatre ans de révolte armée, à soixante
années de contestation du pouvoir romain, et surtout à l’espoir d’une
restauration proche et durable de l’indépendance d’Israël. Seuls quelques
vestiges des fortifications à l’ouest demeurèrent. En
130 apr. J.-C., l’empereur Hadrien visita Jérusalem, pour la plus grande
partie en ruine, et commença sa reconstruction. L’insurrection désespérée des
juifs, menée par Simon Bar Kochba contre les
Romains entre 132 et 135, décida l’empereur à faire de Jérusalem une ville
vidée de son sens religieux et d’en interdire l’accès aux juifs. La nouvelle
ville reçut le nom d’Aelia Capitolina.
Son mur d’enceinte fut construit sur le tracé de l’ancienne muraille, excepté
au sud, où une partie importante de la ville initiale fut rasée. On
sait peu de chose sur l’histoire de la ville entre l’époque d’Hadrien et
celle de l’empereur romain Constantin le Grand, sous lequel le christianisme
devint religion impériale (313). La proportion de chrétiens dans la
population de Jérusalem augmenta progressivement et les pèlerins affluèrent
dans la ville. L’église du Saint-Sépulcre fut édifiée sur ordre de
Constantin, puis, au siècle suivant, l’église de Saint-Étienne, au nord de la
ville, fut construite par l’impératrice d’Orient Eudoxie, qui fit également
rebâtir la muraille sud de la ville et la grande église de Sainte-Marie, sur
la colline du Temple. C’est au Mont des Oliviers que le Christ s’est fait
crucifier et son tombeau serait au Saint-Sépulcre. La
ville chrétienne, après avoir été prise par les Perses, sous le règne de
Khosrô II en 614, reprise par l’empereur byzantin Héraclius en 628 échut, en
637, aux musulmans sous le califat d’Omar Ier. L’Islam est une religion née
au début du VIIe siècle. Dans la péninsule Arabique, un homme, Mahomet, un
conducteur de caravanes que ses voyages ont amené à connaître les croyances
juives et chrétiennes, proclame qu’il n’y a qu’un seul dieu et que ce Dieu se
nomme Allah : l’Islam naît à ce moment. Un sanctuaire, le dôme du
Rocher, fut élevé au-dessus du rocher réputé être le lieu de l’autel du
Temple de Salomon. Les chrétiens furent traités avec indulgence, mais lorsque
les califes égyptiens Fatimides prirent Jérusalem en 969, leur situation
devint plus précaire. Les Turcs Seldjoukides firent la conquête de la ville
en 1078. La destruction de l’église du Saint-Sépulcre fut l’un des motifs des
croisades. En 1099, les croisés, commandés par Godefroi de Bouillon, prirent
la ville et massacrèrent un grand nombre de ses habitants. Le 7 juin 1099,
l’armée croisée arrive devant les murs de Jérusalem. Partis trois ans plus
tôt pour la première croisade, les barons contemplent enfin la Ville sainte,
tombée aux mains des musulmans quatre siècles et demi plus tôt. Ils y mettent
le siège 40 jours durant et parviennent à la prendre. En ces murs sacrés, que
foula autrefois le Christ, ils se livrèrent donc, sans scrupules, à
d’indignes massacres. Jérusalem devint de nouveau une ville chrétienne et la
capitale d’un royaume chrétien jusqu’à sa prise, en 1187, par le chef
musulman Saladin. Cette nouvelle conquête mit pratiquement fin à
l’administration chrétienne. Au XIIIe siècle, Jérusalem fut occupée par les
mamelouks égyptiens et perdit progressivement son importance jusqu’au XIXe
siècle. En tout 8 croisades furent engagées jusqu’à la mort de saint Louis en
1270. Elles se soldent par un échec définitif, puisque la Terre sainte reste
aux mains de l’Islam. Pendant
ces siècles toutefois, de nombreux juifs, fuyant la persécution en Europe,
revinrent à Jérusalem. À la fin du XIXe siècle, ils étaient devenus
majoritaires dans la population. La ville fut prise aux Turcs par les forces
britanniques en 1917 et fut administrée, de 1922 à 1948, dans le cadre du
mandat britannique, donné par la Société des Nations, en Palestine. Après la
création de l’État d’Israël, en 1948, Jérusalem devint le lieu d’âpres
combats entre Juifs et Arabes. L’Assemblée générale des Nations Unies, dans
son projet du 29 novembre 1947, avait proposé que Jérusalem et ses environs
soient déclarés enclave internationale. L’objectif était de garantir un libre
accès à tous les groupes religieux aux lieux saints de la ville. Cependant,
au printemps de 1948, les armées israélienne et jordanienne s’emparèrent
successivement de Jérusalem. Israël occupa la partie ouest de la ville, où se
trouvent les quartiers modernes résidentiels et d’affaires, et la Jordanie,
la partie est, comprenant la vieille ville. Les forces israéliennes
contrôlaient, en outre, un couloir d’accès sur la côte, s’étendant jusqu’à
Tel-Aviv-Jaffa. L’armistice signé le 3 avril 1949 entérina cette division de
la ville entre les deux États rivaux. En 1950, la ville nouvelle devint la
capitale d’Israël non reconnue par l’ONU. Au cours de la guerre des Six
Jours, en juin 1967, les forces israéliennes s’emparèrent de la vieille ville
et la Knesset décréta unilatéralement la réunification de la ville entière.
Cette réunification fut confirmée par la Knesset en 1980, lorsque la ville
fut déclarée "capitale éternelle" d’Israël. Très
nombreuses photos couleur et des schémas. Un très bon livre. |
|||||
|
JÉSUS
ET ISRAËL |
Jules
ISAAC |
Edition
Albin MICHEL |
1948 |
|
L’histoire
de Jésus par un auteur qui essaie de remettre à sa place Jésus dans le
contexte de l’époque c’est à dire dépassionné .Il n'existe pas une pensée
juive uniforme concernant Jésus. Les opinions vont du "Il n'a jamais
vécu" au "Il fut un grand prophète juif". Il suffit de
parcourir rapidement les rayonnages où sont présentés les livres consacrés à
Jésus dans une librairie juive pour se rendre compte de la palette des avis
juifs sur ce personnage. Comme le prouvent les citations rapportées ci-après,
c'est une grande variété, et non l'uniformité, qui caractérise la pensée des
auteurs juifs à propos de Jésus. "Puisque
Jésus était considéré comme un Juif, il y avait encore au sein du judaïsme,
au début du troisième siècle, des liens avec ses disciples. Un passage du
Talmud fait mention des Evangiles et rapporte un enseignement précis, mais
les opinions sont divergentes sur la question." "Nous
cherchions à savoir pourquoi le judaïsme n'avait pas reconnu la messianité de
Jésus. Nous avons découvert que c'était parce que la tradition juive estimait
que la venue de Jésus n'avait pas rempli les conditions messianiques exigées.
C'est pourquoi le judaïsme s'est accroché à l'espoir qu'ultérieurement, Dieu
apporterait la rédemption. Mais les spécialistes n'étaient pas d'accord sur
l'époque où le Messie apparaîtrait et sur son rôle exact." "A
Nazareth – un lieu de si peu d'importance qu'il n'est jamais mentionné dans
l'Ancien Testament – surgit au milieu du peuple juif un personnage particulièrement
sensible et héroïque à la fois. Pour lui, la religion était la chose la plus
réelle qui soit... et bien qu'il fût encore jeune lorsqu'il se lança
publiquement sur les eaux tumultueuses de la Palestine d'alors, sa sympathie
pour l'humanité souffrante était aussi ardente que sa foi était forte Il se
dégageait de la personnalité de cet homme quelque chose d'extraordinaire, une
attirance démesurée et irrésistible. Les gens incultes des campagnes se
sentaient attirés par Jésus et s'attachaient fortement à lui. Au-delà du
tombeau de leurs espoirs évanouis, ils s'agrippaient avidement à son message. Jésus
lui-même n'a pas écrit un seul livre, pas même une ligne, et pourtant on
estime à soixante mille le nombre d'ouvrages qui lui ont été consacrés. Son
histoire est racontée en huit cents langues et dialectes. Son influence d'une
ampleur incomparable a suscité le plus vif intérêt dans toutes les
générations depuis dix-neuf siècles. Il arrive souvent qu'une génération
encense celle que la précédente a brûlée. Moins de cent ans après que l'homme
de Nazareth ait été crucifié comme un vil
malfaiteur, des foules le considéraient déjà comme un être surnaturel et
l'adoraient comme le vrai Dieu. "Le nom de Jésus, écrivit Emensten, est bien plus incrusté que simplement écrit
dans l'histoire du monde." Pour moi qui suis juif, c'est un fait
surprenant, car il ne s'est jamais rien produit de semblable dans toutes les
annales de l'homme." "Pendant
mille neuf cents ans, l'histoire juive, pourtant bien documentée, est restée
dans un silence provocateur au sujet du Juif le plus influent que la terre ait jamais porté. De tous les traitements infligés à
Jésus au cours des siècles, peu sont aussi déroutants que ce paradoxe
étonnant. Car Jésus est né juif; il a vécu sur le sol ancestral de la
Palestine et n'a jamais posé le pied sur un territoire étranger. Il a
enseigné un petit groupe de disciples, tous juifs comme lui. La langue qu'il
parlait était pétrie de tradition et de culture juive. Les petits enfants
qu'il a enlacés étaient juifs; les pécheurs qu'il fréquentait étaient des
pécheurs juifs; il a guéri des malades juifs, nourri des affamés juifs, fait
couler du vin à un mariage juif. |
|||
|
JUDAÏSME B.A- BA |
GERARD CHAUVIN |
Edition
PARDES |
2003 |
||
Toutefois,
les rabbins orthodoxes et conservateurs, réfractaires aux abus de la raison,
pérenniseront le message monothéiste auquel les peuples se convertiront, à
l’avènement du Messie… Roi Davidien, dont l’attente imprègne la liturgie
synagogale et inspire les prières quotidiennes. Ce
B.A BA du judaïsme présente une synthèse de l’histoire et de la morale du
peuple de la bible » de la liturgie et des fêtes. Il s’attache à la
question des rapports des communautés juives (diaspora) avec le monde antique
et l’Eglise ; il montre leur place dans les nations modernes et
distingue l’anti- judaïsme du racisme antisémite. Enfin, il aborde la
question du sionisme politico-religieux avec celle, cruciale pour l’humanité,
du statut de « La Ville de la Paix » : Jérusalem.
Alors,
l’Egypte est frappée durement – les 10 plaies – et Pharaon chasse les Hébreux
(vers 1230 av J. C) qui prennent aussitôt la direction du désert, guidés
par « une colonne de nuée et de feu ». Au Mont
Sinaï, Dieu révèle à Moïse le Décalogue (Les 10 commandements)
qui donnera forme à l’alliance passée avec le peuple hébreux (exode
19). Les « dix paroles »
de la Révélation faite à Moïse par la gloire de YHVH
se gravèrent en traits de lumière et de feu sur les tables du Témoignage. Les
Israélites eux-mêmes, à ce moment
là corporellement purifiés, furent aptes à recevoir la Lumière
Divine, à voir leur Seigneur « face à face »… et non
seulement les Israélites présents, mais aussi ceux des générations passées et
futures, précisera le Zohar. La
première Parole,
perçue par tout Israël, fut Anokhi :
« Je suis » déjà révélée à Moïse, seul, au buisson
ardent. De cette absolue affirmation de L’UN, découle les dix
commandements qui renferment en eux-mêmes les mystères du Ciel, de l’Homme
et de la terre.
« Le témoignage que Dieu porta, au
Sinaï, sur sa propre nature…fut l’affirmation- d’une insurpassable gravité-
de l’unicité de l’indivisibilité de l’Absolu » Rien
ne peut donc lui être retranché, ni ajouté. C’est à Josué, homme de guerre
réputé, qu’il appartint de franchir le Jourdain et de faire entrer le peuple
de Dieu dans le pays promis de Canaan, vers 1200 av. J.C. Le camp israélite
s’établit d’abord à Guilgal, à l’est de Jéricho. Malgré les coalitions
adverses et des combats presque incessants, les tribus des Hébreux
s’établirent progressivement dans le pays. L’attribution
des terres aux 12 tribus, à l’est et à l’ouest du Jourdain, est exposé en
détail dans -Josué 13 et 15- . Elle marque la fin du semi-nomadisme pastoral
et la sédentarisation d’un peuple. Désormais le Tabernacle (la Présence
Divine elle-même : Shékinah) n’est plus mobile, mais installé à demeure
dans un sanctuaire. Au gré des vicissitudes historiques, il sera à Beersheba,
à Sichem, à Silo, etc. seule la tribu de Lévi, dont Moïse était
issu, ne recevra pas d’héritage territorial, elle aura, toutefois, la
haute main sur 48 villes, dispersées au sein des autres tribus. Outre leur
consécration au service divin, les lévites se vouèrent à l’enseignement. Plus
tard lorsque se constitueront les deux royautés d’Israël et de Juda, les
lévites resteront présents dans l’une comme dans l’autre. Les
tables de la Loi seront désormais placées dans « l’Arche
d’Alliance » qui suivra les Hébreux au cours de leurs
pérégrinations. Dieu commanda aussi l’élévation d’un autel pour la
célébration de la fête des pains (Pâques), des moissons et des récoltes. Une
tente dite d’Assignation, du Témoignage, ou d’Alliance, placée au centre
du camp (sous la responsabilité des lévites), sera divisée en deux parties
dont le Saint des Saints ou tabernacle, qui recevra l’Arche et les objets
nécessaires au culte. La traversée du désert dura 40 ans, et c’est du
haut du mont Nebo (en face de Jéricho) que Dieu
montra à Moïse l’étendue de la terre, promise à Abraham, à Isaac et à Jacob.
C’est là que Moïse mourut à 120 ans |
|||||
|
JUDAÏSME ET FRANC MAÇONNERIE- HISTOIRE D’UNE
FRATERNITÉ |
Luc
NEFONTAINE et Jean-Philippe SCHREIBER |
Edition Albin MICHEL |
2000 |
|
Par
sa volonté d’être le « centre de l’union » entre les hommes, mais
aussi par sa symbolique fondée sur le modèle du Temple de Jérusalem ou par
les hébraïsmes qui foisonnent dans ses rituels, la franc-maçonnerie ne
pouvait qu’entrer en sympathie naturelle avec le monde du judaïsme et ses
symboles hébraïques. Pourtant,
les premiers francs-maçons protestants ou catholiques, n’ont pas accepté
immédiatement d’initier des frères juifs dans leurs loges, et les trois
siècles d’histoire de la maçonnerie ne sont pas vierges de tout préjugé
antisémite, surtout en Allemagne. Luc
Nefontaine et J.P. Schreiber, enseignants libres de l’université de
Bruxelles, spécialistes respectivement de la Franc-maçonnerie et du judaïsme,
retracent ici le parcours complexe qui conduisit juifs et francs-maçons de la
défiance au dialogue, en passant par le difficile exercice de la tolérance et
de la fraternité. Ils
étudient aussi l’émergence d’un certain discours de haine qui, à partir de la
fin du 19e siècle, s’en est pris au prétendu « complot
judéo-maçonnique ». A travers cette fresque passionnante, la
franc-maçonnerie se révèle une extraordinaire école de fraternité, qui aura
été pour les juifs, le creuset social et philosophique où se préparait leur
émancipation. Au sommaire de cet excellent livre : Le
difficile apprentissage de la tolérance - Dialogue et tolérance à
l’heure du thé - Pays-Bas, terre de tolérance -
France, la voie royale de l’émancipation - Le pays des
lumières - Intolérance et exclusion en Allemagne -
Des loges juives asiatiques - Lessing et Mendelssohn
- Les lents et longs chemins de l’intégration - Tolérance,
régénération et émancipation - De la Révolution française à la
chute de Napoléon - L’aurore
naissante de Francfort - Sur les traces des armées de
Napoléon - L’apogée du libéralisme allemand - Quand
Berlin fait de la résistance - Le poids de l’antisémitisme en
Europe - Les juifs intégrés en Europe occidentale -
Judaïsme et modernité - Les juifs séfarades dans les loges
- Campagne en faveur de l’admission des juifs en loge - L’affirmation
d’une présence sociale et politique - Appartenance maçonnique et
leadership communautaire - Crémieux, prototype du maçon
juif - L’Alliance israélite universelle - L’affaire
Dreyfus et ses avatars - En Angleterre, des maçons engages
- Vers
une religion de l’humanité - La maçonnerie et le
judaïsme moderne - Face aux dogmes catholiques - La
maçonnerie vue par le judaïsme traditionnel - Pratiques
maçonniques et pratiques religieuses - Le
mythe du complot judéo-maçonnique - La thèse -
Descente aux enfers - La corruption de la société
chrétienne - Les protocoles des Sages de Sion - Aspects contemporains d’une histoire partagée - La maçonnerie palestinienne en Israël - Le B’nai B’rith - Des rites réserves pour les juifs ? - Les hébraïsmes dans la franc-maçonnerie - Un ésotérisme juif et maçonnique : la kabbale - Judéité et maçonnéité - Des points de vue communs ou essai de concordisme - |
|||
6 K
|
KABBALAH – LETTRES INITIATIQUES |
Jacques OUAKNIN |
Edition Le Mercure Dauphinois |
2011 |
|
Un
livre riche, vivant, généreux et profond qui a le mérite de parler simplement
des choses complexes de la tradition juive, de ses rites, de sa philosophie,
de ses mythes et de son folklore. Ce livre est un pari audacieux, celui de
transmettre de la façon la plus existentielle les grands thèmes de la
Kabbale, c'est-à-dire l’univers mystérieux de la mystique juive. Et ceci sans
mystification. Projet difficile qui se devait d’éviter deux écueils opposés, l’érudition technique d’un côté et la dérive new-âge de l’autre. Seule l’expérience de rabbin de communauté, me semble t-il, a permis à l’auteur de trouver le ton juste. Voici
donc un livre qui expose une morale plus impressionniste qu’impressionnante,
par petites touches, qui souligne tous ces petits gestes et comportements qui
font que la vie est toujours plus lumineuse, plus riche et plus
enrichissante, plus joyeuse aussi. Le sens de la vie n’est jamais donné à
l’avance, mais se découvre à chaque fois comme première fois. C’est un
surgissement de nouveautés qui vient défaire le risque du déjà su, du déjà
entendu et du déjà compris, un livre vif, brillant et honnête. Ce
livre de transmission de la Kabbale, se fait sous forme de 32 lettres à un
ami. 32 en effet n’est pas le fait du hasard, dans la tradition juive le
chiffre 32 signifie le cœur, maître
mot de cet ouvrage, « qui vient du cœur
et va droit au cœur ». Avoir à cœur de s’occuper des autres,
des petites choses de la vie, des petites attentions, des petits sourires et
gentillesses. C’est à ces petites choses que l’auteur consacre ses
méditations et les transmet à travers ces 32 lettres, clins d’œil aux 32
sentiers de la Sagesse, composés des 22 lettres de l’alphabet hébraïque,
associées aux 10 Sefirot. Accueil
et réception
sont le sens exact du mot Kabbalah en hébreu. Et au-delà de tout le
corpus de la tradition mystique qui porte le même nom, c’est la mise en œuvre
de l’esprit de la Kabbale qui nous est ici présentée. C’est donc autour de
ces 32 lettres que s’organise une farandole d’idées, tissant un texte fait de
récits du Shabbat, des traditions, de son rythme de vie, de connaissances
savantes, d’aphorismes divers et de méditations philosophiques et
théologiques. Tout
au long de ces lettres, l’auteur montre comment le Nom de Dieu guide
l’initié, afin qu’il devienne meilleur. L’homme doit cultiver son jardin
intérieur d’une manière incessante, sachant que le but à atteindre n’est pas
forcement l’objectif mais que le plus important est la façon de vivre au
quotidien. L’auteur nous parle de : La Kabbale – de l’essence de Dieu - La Thora – L’homme, créature singulière et l’image de Dieu – Amour et rigueur – Vivre avec Dieu – Amour du prochain –Les noms de Dieu – La Guématria – Les Sefirot – Les quatre mondes – Le Shabbat et ses bienfaits – La création, un projet d’Amour – Formation de l’homme – Le Tétragramme Y-H-V-H- Jérusalem Céleste et Jérusalem Terrestre – La femme et le discernement – Le péché originel – Illustrations du Tsimsoum – la femme source de bénédiction et d’harmonie – La Cantique des Cantiques – Shlomo et la Shoulamite – Shir Hashirim – Les quatre éléments de la nature et les différents niveaux d’interprétation – Le corps, l’âme et l’esprit - le chiffre quatre – Le Hassidisme et la musique – Le Shabbat à la synagogue – Textes du Lekha Dodi – Les Mitzvot – Le chandelier à 7 branches – L’influence des Sefirot – Shamom Alékhém – La Shékina – Cérémonie du vin – La Kedousha – Le Kiddoush – Répartition des Sefirot sur le corps humain – Les diverses purifications – La mer morte – La nourriture et l’élévation spirituelle – Symbolique de l’étoile de David – Le partage da pain – Tamar l’ancêtre du Messie – Elaboration du pain – Partage du pain (le Motsi) – Le déterminisme (Mazal) – La Foi ( Emouna) – La vertu de l’hospitalité – La table, symbole de l’autel des sacrifices – Le repas des fêtes – Tradition écrite et Tradition orale – Les Zémirot – Nourriture céleste et terrestre – La Kabbalah, transmission dans un face à face – Les 3 piliers de le foi juive – Bar Yohaï - Le Zohar – Niglé et Nistar – Mashiah, l’huile d’onction – Malkut – Enseignements de Rabbi Yohaï – Aher :l’autre – Kav Yarok, la ligne verte – Les 32 voies de Sagesse – Le Yound – Le Zimmoun – Les diverses Bénédictions – Anthologie du Judaïsme – Lois de Kacherout – Le Bien et le Mal – Le regard objectif de l’homme et de Dieu – L’âme et le corps – La porte du Paradis céleste – On ne meurt jamais seul – Le recyclage des âmes : le Guilgoul – Les 5 niveaux de l’âme – Les réincarnations successives – La cérémonies de séparation – Le repas de la Reine – Les Kabbalistes - |
|||
|
kabbale
- b.a. -ba |
Gérard
chauvin |
Edition
PARDES |
2003 |
||
À
tendance dévotionnelle, mystique ou philosophique, la « vraie Kabbale » est
bien différente d’un certain « kabbalisme » en
vogue aujourd’hui. Il serait vain de s’y aventurer sans une connaissance
suffisante de la Bible (Torah) et de la langue hébraïque de la révélation,
sans attaches religieuses ni guide éclairé… Juda Halevi avertit : « La
Kabbale n’est bonne qu’avec un cœur bon »… Un cœur suffisamment détaché du
monde et épris d’Absolu.
|
|||||
|
KABBALE ET COULEURS – LES MYSTḔRES
DES NUANCES DE LA LUMIḔRE - |
Georges Lahy |
Edition Lahy |
2016 |
||
Mais effectivement, ces couleurs font allusion
aux perceptions reçues depuis les plus hautes Sources. Ainsi, par exemple, Geburah (Rigueur) est responsable de la victoire dans une
guerre. La guerre implique l’effusion de sang, or le sang est rouge, il
s’associe parfaitement à la couleur rouge de cette Séphira. La couleur rouge
exprime également la haine, la colère et la rage. Ceci est évident. Nous
attribuons par conséquent la couleur rouge pour le Jugement. En outre, tout
ce qui est rouge est tiré de la puissance de cette Racine. Ceci a été examiné
en détail dans la « Porte d’Essence et Fonction ». De même, la couleur blanche
indique la pitié et la paix. Ceci parce que les gens avec des cheveux blancs
sont habituellement miséricordieux. Par exemple, les anciens et les âgés ne
combattent généralement pas dans les armées. Donc, si vous souhaitez
représenter la paix et la Séphira Hesed, vous devez
vous la représenter avec la couleur blanche. Il n’est pas à douter que les
choses qui sont blanches émanent du pouvoir de cette Racine. Mais tout cela a
déjà été expliqué dans le Portail mentionné plus haut. Ceci, est alors
l’interprétation adéquate de la relation entre les couleurs et les Sephiroth.
Les couleurs sont utilisées sous forme d’allégories et font allusion à leurs
fonctions et ce qui en résulte. Les Sephiroth n’existent pas dans un espace
donné, par conséquent il est impossible de les différencier excepté à travers l’allégorie. Ceci peut être fait
seulement quand nous utilisons des couleurs dont l’allégorie représente les
Sephiroth. Nous pouvons concevoir ainsi les Sephiroth comme étant
différenciées, en élévation ou en croissance, d’après la
relation existant entre une couleur et une autre. Les dynamiques des
Sephiroth peuvent être imaginées entièrement à travers l’interaction des
couleurs. Tout ceci est pour « faciliter l’oreille physique », en permettant
l’expression verbale de ces concepts. Il est certain que les couleurs peuvent
servir alors de support aux animations des Sephiroth. Elles sont aussi utiles
pour transmettre l’influx d’une Séphira donnée. Ainsi, si vous souhaitez
transmettre l’influx de clémence de la Séphira Hesed,
méditez sur la couleur associée avec cette Séphira. Représentez la couleur de
l’attribut que vous désirez. Si vous souhaitez la clémence pure, alors cette
couleur sera d’un blanc pur. Si votre demande implique un petit degré de
clémence, représentez une blancheur plus douce, comme celle du « mortier du
Temple ». Si un individu souhaite accomplir quelque chose à
travers l’influx du Jugement, il doit faire usage d’un vêtement de cérémonie
rouge. Il méditera ensuite sur le Tétragramme, représenté dans des lettres
rouges. De même, dans une activité orientée vers la Clémence, et désirant
diffuser la puissance de Hesed, il doit porter des
vêtements de cérémonie blancs. Ceci est clairement montré chez les Cohanim (prêtres). Leur fonction était de diffuser
l’influx à partir du côté de la Hesed. Ils
portaient donc des vêtements de cérémonie blancs, qui indiquent la paix. Au
Yom Kippour (le Jour d’Expiation), le Grand-Prêtre retirait également ses
vêtements sacerdotaux d’ors et portait du blanc. Le service entier de ce jour
était exécuté dans des vêtements de cérémonies blancs, et la raison donnée à
cela est qu’« un accusateur ne devient pas un défenseur », puisque l’or indique le Jugement. La blancheur,
cependant indique la pitié que le Grand-Prêtre recherchait. Le
même principe est vrai pour les amulettes. Quand on fait une amulette (Qaméâ) pour transmettre le flux de Hesed,
il faut dessiner le Nom nécessaire en lettres blanches lumineuses. Ceci
accroît l’efficacité du Nom. De même, quand on recherche le Jugement, il faut
dessiner le Nom associé avec le Jugement en rouge. Le sang de chèvre est
souvent utilisé dans ce but, puisqu’il fait allusion au Jugement, à la fois
par sa couleur et sa source. Ces choses sont bien connues et sont évidentes
chez ceux qui écrivent des amulettes, même si nous n’avons pas de penchant
pour ces pratiques. Il est donc connu que quand les Noms sont dessinés sur
des amulettes, ceux qui impliquent le Jugement sont dessinés en rouge, ceux
qui impliquent l’Amour, en blanc, et ceux qui concernent la Pitié en vert.
Cela est entièrement connu grâce aux Maguidim, qui
ont appris les méthodes d’écriture des amulettes. Tout
ceci apprend que les couleurs peuvent servir comme un canal pour les forces
qui sont transmises à partir du haut. C’est aussi à mettre en parallèle aux
rites de certains idolâtres. Quand ils offrent l’encens, ils savent
influencer la puissance d’un signe particulier du Zodiaque. En pratiquant ces
rites, ils useraient de vêtements de cérémonie dont la couleur est associée avec
leurs actes. Il est évident que cette façon de faire peut
être retrouvée dans le pectoral du Grand-Prêtre. Celui-ci contenait
douze pierres précieuses, chacune avait une couleur différente, en allusion à
la transmission de l’influx de la source spirituelle de chacune des Douze
Tribus. Ne refusez pas ce concept. Les alchimistes apprennent que, quand une
personne regarde de l’eau courante, la Bile Blanche (ou l’Humeur Blanche) est
éveillée en elle. Donc, quand quelqu’un a de l’insomnie et ne peut pas dormir,
ils placent des tuyaux avec de l’eau courante devant lui afin de, stimuler la
Bile Blanche. Ceci accroît l’humidité dans son corps, et il est capable de
dormir. La même chose est vraie dans notre cas. Quand un initié effectue un
vol avec son esprit, il constate que ceci est inestimable. Les couleurs qui
sont visibles à l’œil, ou qui sont représentées en esprit, peuvent avoir un
effet sur le spirituel, quoique les couleurs elles-mêmes soient physiques. » Au sommaire de cet
ouvrage : Les couleurs - les nuances - les quatre fondements colorés du cosmos - les trois couleurs du champ des pommiers - les six couleurs du commencement - les sept mers - le nom en quarante-deux teintes - les quarante-cinq couleurs-clés - les soixante-dix palmiers colorés d’Elimah - Feu noir sue Feu blanc - entre blanc et rouge - émanation des Sifiroth et nuances colorées - Sifiroth et couleurs dans la Kabbale médiévale - Sefiroth et couleurs dans le Pardès Rimonim - Tékéléth, l’hirondelle du clair-obscur - L’habit pourpre - l’écarlate purificateur - les gradations du saphir - les couleurs du voile du Temple de Salomon - la parokèth - Argaman - le secret des couleurs d’après leurs types - la Menorah et les sept lumières - |
|||||
|
KABBALE MODÈLE D’UNIVERS |
GRAD |
Edition
du ROCHER |
1999 |
|
Un
modèle d’Univers se limite à décrire la « réalité » observable, il
n’a donc pas à prendre en compte la réflexion éthique, l’expérience
religieuse, voire la symétrie qui précède la première minute du cosmos. A la
veille d’affronter les mutations profondes du troisième millénaire, l’homme
du cyberespace redécouvre à son insu la sémantique de la kabbale, car le seul
modèle d’univers qui survit toujours aux théories physiques est l’arbre
séphirotique des kabbalistes. Pour
A. D. Grad, la kabbale est la science verticale par excellence, son caractère
polymorphe n’est pas sans résonnance variées. Pour la datation commode du
Moyen-Âge, la kabbale est qualifiée d’extatique-prophétique avec Abraham
Aboulafia (1240-1291), de théosophique-théurgique avec Joseph Gikatila (1248-1325) ou Moïse de Léon (1240-1305). Les
« cousinages » sont édifiants, qui relient l’aristocratie de
l’hébraïsme à la magie populaire, la philosophie néo-platonicienne au
discours talmudique. Les
kabbalistes sont plus des mystagogues que des religieux. L’initiation aux
mystères est l’apanage d’une élite « Approfondir
la parole, c’est la gloire des rois » dit Salomon (Proverbes XXV) Les kabbalistes placent l’étude au dessus de la prière, car si prière il y a, elle doit être très courte, en hébreu. Par contre, s’il s’agit de « donner de la puissance à Elohim », les kabbalistes considèrent qu’il est de leur devoir de projeter l’énergie humaine au plus haut niveau. |
|||
|
kabbalistes chrÉtiens
les cahiers de l’HermÉtiste |
Divers
auteurs |
Edition
Albin Michel |
1979 |
||
Pic
soutenait que la Kabbale représentait une chaîne ininterrompue de la
tradition orale qui fut révélée à Moïse sur le Mont Sinaï. Dans son Oraison
sur la Dignité de l’homme, il défendit cette notion en ajoutant que la
Kabbale est implicite de la doctrine chrétienne : « Il n’existe aucune
science qui nous certifie mieux la divinité du Christ que la magie et la
Kabbale » nous déclare Pic dans ses Conclusions. Par magie, Pic signifie, non
seulement les arts hermétiques (alchimie, astrologie, divination…) mais aussi
la physique, la chimie, l’astronomie, toutes sciences que son époque ne
distinguait nullement de l’hermétisme. Esther Cohen nous dit à ce propos :
« Pour le comte de la Mirandole, seule la magie cabalistique peut
compléter et perfectionner la philosophie naturelle proposée par Ficin; c’est
seulement grâce à elle que la magie entendue comme copula mundi trouve sa
dimension la plus profonde ». Ainsi naquit l’association intime de la Cabale
chrétienne et de la magie, telle qu’elle sera remise en lumière par les
occultistes du 19e siècle qui puisèrent dans les oeuvres de la Renaissance la
source de leurs inspirations. Mais,
cette reformulation de la Kabbale dans un sens chrétien et hermétique porte en
elle une recherche de la vérité, une quête visant à affirmer l’existence à la
fois du christianisme comme volonté divine exprimée jusque dans l’Ancien
Testament et comme tentative de redécouverte des connaissances dites
hermétiques. Cette oeuvre de traduction et de reformulation inaugure ainsi
une nouvelle manière de voir et de formuler le monde et d’appréhender la
nature. Cette Cabale chrétienne est nouvelle aussi car « Pic ne
travaille pas directement à partir de la Cabale juive, mais sur des traductions
latines auxquelles il donne ses propres mots, créant tout un univers
symbolique au centre duquel les religions se rejoignent … il explore la
cabale juive pour en faire autre chose, pour faire surgir de ses combinaisons
et permutations complexes un espace discursif où, finalement, le judaïsme et
le christianisme ne feraient plus qu’un. » (Esther Cohen, Le Corps du
diable). La
clé de la Cabale chrétienne réside donc principalement dans l’idée que la
Kabbale, tradition orale de l’Ancien Testament, ne pouvait que prévoir
l’avènement du christianisme : « Aucune science ne nous rend plus sûrs
de la divinité du Christ que la magie et la Cabale » (Pic de la Mirandole,
Neuvième Thèse, Neuf cent conclusions philosophiques, cabalistiques et
théologiques, édition Allia, 1999) et dans ses Conclusions Magiques et
Cabalistiques il ajoute : « par la lettre Shin, située au coeur du nom
de Jésus, la Cabale nous signifie que le monde reposait parfaitement comme
s’il était dans sa perfection, et comme Yod est unie à Vav, chose qui survint
dans le Christ, qu’il fut le véritable fils de Dieu et de l’homme ». |
|||||
Retour à l'index des chapitres
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||